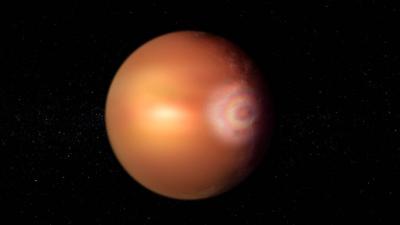Le chercheur de l’Université Laval a participé à l’élaboration de l’Indice canadien du mieux-être (ICMÊ), un regard unique sur la qualité de vie globale des Canadiens et Canadiennes.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Agence Science-Presse (ASP) — Mesurer scientifiquement le bonheur, est-ce vraiment possible?
Simon Langlois (SL) – C’est possible, mais pas simple. Des techniques existent pour mesurer ce qu’on peut appeler le « bien-être », le « bonheur social », la « satisfaction », la « privation » ou la « bonne société ». Toutefois, il faut faire la distinction entre un indice de mesure construit de manière subjective ou un indice objectif de réalité subjective. Par recoupement des indices objectifs, mesurant les différents revenus et les différents besoins, nous arrivons à cerner la situation, à dessiner le bonheur d’une population et des individus.
ASP — N’est-ce pas un défi de penser que les indices peuvent tout mesurer... même le bonheur?
SL – Évidemment, toute mesure représente une réduction, un simple reflet d’une réalité multiple. Cet indice fait reculer les frontières afin d’obtenir une représentation stylisée de la réalité. Le bonheur varie selon les individus. Il dépend de ce qu’on a — la réalité mesurable —, mais aussi de nos aspirations. Ces aspirations sont plus grandes chez la classe moyenne que chez les riches (qui peuvent se payer ce qu’ils désirent) et les plus pauvres (qui disposent d’une marge de manœuvre si étroite qu’ils ne se sentent pas privés de vacances dans le Sud, même s’ils en rêvent). Ceux qui y ont déjà goûté — la classe moyenne — se sentent plus frustrés.
ASP — La richesse ne fait pas forcément le bonheur. La privation ferait-elle le malheur?
SL – La privation dépend du cadre de référence. Il faut prendre en compte aussi les références à notre propre histoire, les situations passées qui peuvent être meilleures que celles que l’on vit. Les jeunes diplômés, par exemple, lorsqu’ils sortent de l’université, ont de grandes aspirations. C’est l’horizon des possibles, jusqu’aux premiers revers.
Les frustrations proviennent souvent de la mobilité sociale descendante, du fait que l’on soit moins riche ou moins éduqué que nos parents ou nos pairs. Dans les pays occidentaux, nous avons une chance sur deux d’être moins privilégiés en raison du chômage ou des récessions. Nous vivons aussi dans une société qui favorise le sentiment de privation. Notre panier consommable s’est beaucoup élargi depuis 25 ans, tout comme nos aspirations. L’univers des possibles s’avère plus vaste et cela provoque une extension de nos attentes, mais aussi la détérioration du sentiment de bien-être, surtout chez les plus matérialistes d’entre nous.
ASP — Parlez-nous de la représentation sociale du bonheur?
SL – Dans les sociétés traditionnelles, et chez nous autrefois, les paysans vivaient au rythme des saisons. Il fallait semer, moissonner et pour cela une certaine solidarité familiale et entre voisins était de mise. L’Église était un lieu de rassemblement où l’on tissait des liens sociaux, où les futures alliances (familiales) prenaient corps. À l’époque, la famille était le principal lieu de protection individuelle et la sexualité était fortement contrôlée. Notre société ne fonctionne plus comme cela. Ces anciennes valeurs ont été abandonnées par les sociétés occidentales qui valorisent la rationalité et le progrès. Le bonheur possède donc une représentation sociale selon la société de référence dans laquelle nous évoluons. Ce qui faisait le grand bonheur des gens, il y a un siècle, posséder une voiture par exemple, est devenu banal. Maintenant, nous vivons dans une société qui fait une grande place à l’économie et à l’utilité, ce qui offre une vision souvent réductrice de nos besoins. Ils passent souvent dans l’avoir et le matériel.
ASP — Comment mesurer ce « bonheur social »?
SL – Différents pays ont des indices de mesure, parfois très complexes comme l’indicateur Siglitz sur le progrès social en France ou la qualité de vie du Bureau fédéral suisse de statistique. Au Canada, nous avons conçu l’Indice canadien du mieux-être pour mieux appréhender ce bonheur social. Cet indice se penche sur le niveau de vie des Canadiens, leur santé, la qualité de l’environnement, leur niveau d’éducation et de compétence, leur façon d’utiliser le temps, le dynamisme des collectivités, la participation au processus démocratique et la situation des arts, de la culture et des loisirs. Cet indice global, encore en développement, permettra de mesurer la réalité canadienne, mais aussi de pouvoir se comparer avec d’autres nations. Ces indices s’avèrent pertinents, car ils permettent d’aller plus loin que les indicateurs traditionnels (PIB, logement, emploi, etc.) pour cerner le bien-être. Et cela, de manière objective.