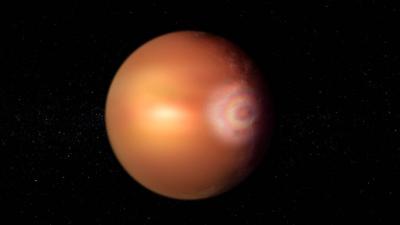« Une plaie syphilitique sur le beau corps de Rio de Janeiro [1] » (notre traduction), voilà une représentation des favelas que critique férocement l’urbaniste Janice E. Perlman. Un danger certain accompagne donc un tel discours étatique: au fil des décennies, il a justifié l’empressement des autorités brésiliennes à prendre des mesures pour éradiquer, ou à tout le moins pour limiter, le « problème social » des favelas.
Une « lèpre de l’esthétique » à éradiquer
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Depuis l’apparition de la première favela à Rio de Janeiro dans les années 1880 [2], les autorités ont revu bon nombre de fois les politiques municipales et étatiques de gestion des favelas, balançant constamment entre l’aide aux plus démunis et la répression. Les plans d’éradication des favelas et ceux d’urbanisation et de modernisation se sont succédé. Les politiques concernant la favela menèrent même à une longue période que le géographe brésilien André Reyes Novaes nomme silence cartographique [3] : dans la première moitié du 20e siècle, sur les cartes de la ville de Rio, les favelas étaient réduites à des espaces vides à cacher et à passer sous silence.
L’emploi de métaphores corporelles de la favela comme un cancer depuis les années 1920 ont inspiré le modèle épidémiologique présent dans le discours des artistes, des ingénieurs civils et des élus de Rio de Janeiro sur les favelas. Déjà, en 1927, l’urbaniste et architecte français Alfred Agache, chargé de présenter à Rio une série de conférences sur la ville, donnait le ton en prononçant l’un des premiers discours sur la nécessaire éradication de la favela :
Il est urgent qu’on règle un destin immédiat, qu’on lève une barrière prophylactique contre l’infestation démesurée des belles montagnes de Rio de Janeiro par le fléau des favelas [sic] – lèpre de l’esthétique, qui […] s’est propagée partout, en salissant et amenant de la misère aux quartiers plus jeunes [4].
Par la suite, les opérations policières ont été successivement assimilées dans les discours officiels à des opérations chirurgicales, de purification ou d’assainissement, d’où l’emploi de l’expression « hygiénisation des favelas [5] » pour se référer à ce type d’intervention de la part de la police.
Les métaphores assimilant la favela à une maladie ou à une infection témoignent du fait que la favela est gérée selon une perspective de biopouvoir *, et partent de la prémisse que l’analogie est possible entre une ville et un corps humain ou, plus encore, de celle voulant que la ville est un organisme qui mime la structure du vital, qui est à protéger à tout prix contre les maladies. De fait, dans la rétrospective historique qu’il dresse des discours politiques occidentaux des derniers siècles, le philosophe italien Roberto Esposito note que « la métaphore la plus influente que la politique ait employée pour représenter la vie d’une société fut celle du corps [6] » (notre traduction).
L’analyse immunologique de la situation urbaine de Rio n’est d’ailleurs pas sans faire écho à un autre discours historique funestement célèbre : le dangereux discours nazi sur la maladie infectieuse que représentaient les juifs, qui menaçaient la santé ainsi que la « pureté » de la nation allemande par leur statut de « bactéries », de « parasites », de « virus » et de « microbes [7] ». L’eugénisme nazi a en effet employé la « biologisation » de la politique, c’est-à-dire l’adoption d’un discours biopolitique médico-hygiéniste, pour légitimer les camps de la mort et la solution finale, en faisant de l’extermination des juifs, perçus comme source de contagion, une nécessité pour l’hygiène et la survie de la nation malade plutôt qu’une question idéologique.
Une étymologie déjà « contaminée »
Fait curieux, le terme favela contient en lui-même un indice de la charge épidémiologique qui est associée à cet espace urbain. La sociologue Licia Valladeres rappelle qu’étymologiquement, ce mot, qui vient du nord-est du Brésil, renvoie en portugais à une mauvaise herbe urticante et indésirable, le Jatrophaphyllacantha, extrêmement difficile à éradiquer [8].
La « favela », aussi connue sous les noms de « faveleiro », « faveleira » ou « mandioca-brava [9] », est une herbe qui se multiplie continuellement, qui réapparaît sans cesse malgré les efforts pour l’anéantir pour de bon et qui produit des brûlures dévastatrices sur la peau de ceux qui s’en approchent. Par conséquent, le choix même du terme favela repose dès le départ sur une certaine dépréciation de ces espaces. De tels préjugés induits par l’étymologie sont renforcés par le fait que la favela est forcément construite sans normes urbanistiques précises et, qui plus est, à l’aide de matériaux généralement trouvés ici et là qui ne favorisent pas la conception d’édifices fonctionnels.
Une contagion sanitaire, mais également morale
Ce caractère désorganisé de la favela s’est souvent traduit dans le discours étatique brésilien par la représentation de cette entité spatiale comme source de chaos et de problèmes d’ordre sanitaire, mais également d’ordre moral. Cette réalité propre aux bidonvilles de partout à travers le monde a par ailleurs amené l’architecte états-unien Richard Meier à écrire en 1975 que « [les] groupes d’individus vivant dans les bidonvilles versent dans ce que l’on appelle la pathologie sociale : le vice, la délinquance, la prostitution, le proxénétisme, etc. [10] ». Or, avec cette affirmation, l’architecte reproduit la marginalisation discursive des pauvres des bidonvilles et construit lui aussi une représentation, non exempte de préjugés, tant de la moralité que de la salubrité de ces espaces urbains comme étant, littéralement, pathologiques. Le fait d’associer dans le même concept la pathologie à la socialité est d’ailleurs un indice significatif de la transposition du discours bio-immunitaire à la conception urbaine de la ville comme « corps » social sujet à la contagion.
La peur du cancer urbain et de l’insalubrité générale que représente la favela dans l’imaginaire des élus brésiliens a non seulement servi à justifier les interventions policières visant son éradication, mais elle a également joué un rôle prépondérant dans les mesures d’exclusion à caractère socioéconomique telles que la séparation entre les quartiers riches de Rio et les quartiers plus défavorisés. Selon Esposito, depuis l’apparition du sida, l’exigence immunitaire s’est accrue de façon démesurée, au point où le paradigme de l’immunisation serait devenu l’une des préoccupations fondamentales des autorités et des populations occidentales [11]. L’émoi international qu’ont causé dans la dernière décennie les virus Zika et Ebola, le virus du Nil occidental ou celui de la grippe H1N1, suffit pour constater la panique immunitaire actuelle des classes dirigeantes. Celles-ci s’octroient alors les missions de protéger leurs territoires contre ces virus et d’éliminer toute source de contamination potentielle. Or, à l’ère actuelle où la circulation des biens, de l’argent et des personnes est plus libre que jamais et où les frontières sont perméables à ces flux, toute volonté d’immunisation sécuritaire et de « mise en quarantaine » des favelas pour empêcher la contagion sanitaire et morale du reste de la ville et toute séparation spatiale hermétique entre les beaux quartiers et les favelas semblent utopique.
Le tourisme de la pauvreté dans les favelas
Toutefois, malgré la persistance des craintes en matière sanitaire et morale, la valorisation depuis les années 1980 de ces lieux de vie par un nombre grandissant d’urbanistes qui les présentent comme une solution originale d’habitation populaire semble avoir poussé les gouvernements municipaux et étatiques brésiliens à abandonner l’idée d’éradiquer les favelas et de déplacer leurs populations [12]. La tendance est plutôt à la légalisation et à l’urbanisation de ces espaces visant leur transformation en quartiers officiels.
De plus, depuis la sortie en 2002 du film brésilien Cidade de Deus [La cité de Dieu], de Fernando Meirelles et Kátia Lund, l’intérêt international tant culturel que commercial pour les favelas a grimpé en flèche. En témoigne notamment leur présence dans plusieurs œuvres cinématographiques ultérieures comme City of Men (2007), FavelaRising (2005) et Tropa de Élite [Troupe d’élite] (2007), et même dans des vidéoclips comme Beautiful (2003), de SnoopDogg. La favela a gagné en renommée internationale au point où l’expression « favela chic » a fait son entrée dans l’univers de la mode et de la musique [13].
Le phénomène naissant du « tourisme de la pauvreté [14] » dans les favelas de Rio s’inscrit dans ce contexte, phénomène qui pourrait également donner une raison économique aux dirigeants municipaux, étatiques et fédéraux de ne plus souhaiter leur disparition, voire de préconiser leur acceptation et éventuellement leur valorisation patrimoniale [15]. Alors que Karl Marx écrivait il y a plus d’un siècle que la pauvreté était la seule chose que le capitalisme ne pourrait jamais acheter en raison de son absence de valeur d’échange [16], les tours guidés des favelas offerts par un nombre croissant d’agences de tourisme semblent avoir poussé l’idéologie néolibérale à son paroxysme, transformant la pauvreté même en objet de consommation.
La favela touristique et consommable est ainsi mise en valeur par les agences de voyages depuis les années 1990, mais surtout depuis le début du 21e siècle, en tant que destination touristique hors pair pour découvrir le « vrai » Brésil [17]. Ce « musée à ciel ouvert [18] » prêt à être exposé au regard international – pour reprendre l’analogie de la professeure de littérature comparée Beatriz Jaguaribe – serait symptomatique de la société du spectacle décrite par l’essayiste Guy Debord [19], qui s’inquiétait déjà en 1967 de la marchandisation des expériences humaines. La porte ouverte au tourisme dans les favelas serait susceptible de fournir les arguments économiques nécessaires à la ville de Rio pour mettre fin à son discours biopolitique de la favela comme menace sanitaire et morale. Par conséquent, après avoir été stigmatisée pendant près d’un siècle, la favela pourrait bien se voir octroyer ironiquement d’ici quelques années une place de choix dans les circuits touristiques et sur les cartes postales de Rio, au même titre que le « Pain de sucre » et le « Christ rédempteur ».
L’acceptation et la valorisation des favelas par l’État brésilien sont cependant loin d’être complètement gagnées. En effet, le regard international braqué sur la métropole brésilienne en raison de la tenue récente de méga-événements politiques et sportifs internationaux à Rio de Janeiro – tels que la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) en 2012, les Journées mondiales de la jeunesse et la Coupe des confédérations en 2013, la Coupe du monde de football en 2014 et les Jeux olympiques d’été en août 2016 – a mené à un certain recul dans les plus récentes politiques d’acceptation des favelas [20]. L’État brésilien, dans un nouveau plan de restructuration également influencé par la spéculation immobilière, a renoué pour l’occasion avec ses campagnes de relocalisation des habitants de certaines favelas situées près du centre-ville et près des installations sportives, forçant le départ de nombreuses familles [21]. Alors que la métropole brésilienne est plus que jamais sous les projecteurs, la question de la représentation des favelas de Rio de Janeiro et des politiques étatiques qui les concernent demeure brûlante d’actualité. Cancer grugeant le corps de Rio, solution originale aux problèmes urbainsou musée touristique consommable : quelle représentation de la favela dominera dans la décennie suivant les Jeux olympiques de 2016 ?