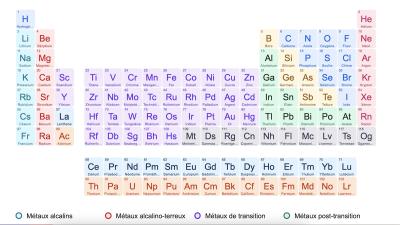Il aura fallu 11 ans pour que sa découverte soit confirmée par des scientifiques britanniques —lorsque ceux-ci découvrirent le fameux trou dans la couche d’ozone, en 1985. Jusque-là, l’idée que nos banales bonbonnes aérosol détruisent à petit feu la couche qui, là-haut, nous protège des rayons ultraviolets du Soleil, avait été accueillie avec scepticisme par une partie de ses collègues, et avec hostilité par l’industrie.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
F. Sherwood Rowland, professeur de chimie de l’atmosphère à l’Université de Californie, allait être récompensé par le Nobel de chimie en 1995. Il est décédé le 10 mars dernier des suites de la maladie de Parkinson, à 84 ans.
La percée des Britanniques, en 1985, a été si spectaculaire qu’elle a mobilisé les pouvoirs politiques de dizaines de pays pour accoucher, à peine deux ans plus tard, du Protocole de Montréal, un traité international qui bannissait la production, entre autres, de ces composés appelés CFC (chlorofluorocarbones), principaux responsables de la détérioration de la couche d’ozone.
Le Protocole de Montréal fut le premier traité environnemental de l’histoire, et il est souvent cité en modèle, alors que les négociations pour un traité sur les gaz à effet de serre piétinent depuis deux décennies.
Le décalage entre ces deux dossiers, ou ces deux époques, est souligné par les blogueurs de Real Climate dans l’hommage rendu à Rowland:
Dans les deux cas, il existe un problème atmosphérique global, causé par des émissions spécifiques, potentiellement dangereuses, problème pour lequel la science fournit des preuves solides (mais jamais de preuve absolue) et pour lequel des observations précédaient de plusieurs années les prédictions. Dans le cas de l’ozone, cela a conduit à d’importantes actions préventives, par l’intermédiaire du Protocole de Montréal et de ses amendements.(...) Dans le débat public, plusieurs des climatosceptiques (comme Fred Singer) ont commencé leur carrière en niant que les CFC affectent l’ozone, utilisant plusieurs des mêmes arguments qu’ils utilisent maintenant sur les changements climatiques.
Le comité Nobel, en honorant Rowland et son collègue Mario Molina en 1995, a jugé de leur travail qu’il avait «sauvé le monde de la catastrophe».
Au-delà des données, le débat public
Dans leur article paru dans Nature en 1974, Sherwood Rowland et Mario Molina présentaient des résultats à première vue alarmants : lorsque les molécules de CFC se perdent dans la haute atmosphère, elles sont bombardées par des rayons ultraviolets. Leurs atomes de chlore peuvent alors absorber une énorme quantité de molécules d’ozone: jusqu’à 100 000 molécules d’ozone pour chaque atome de chlore. Pire, leur effet dure plusieurs décennies.
Des résultats alarmants, mais difficiles à accepter: les CFC étaient après tout présents en abondance, à cette époque, dans les déodorants, les produits pour les cheveux et les réfrigérateurs, et on ne voyait pas pourquoi, dans la stratosphère, ils pourraient avoir un comportement qu’à notre «altitude», personne n’avait remarqué. Comme l’étude n’avait été faite qu’en laboratoire, il avait été facile de la mettre de côté en attendant d’autres informations.
Cela n’avait pas empêché Rowland d’intervenir sur la place publique et dans les médias au début des années 1980, allant jusqu’à se faire un promoteur de l’idée d’un moratoire sur les CFC. Ce qui lui a valu les foudres de l’industrie, qui fut prompte à invoquer une catastrophe économique si d’aventure, les gouvernements décidaient de bannir les CFC. Une publication corporative appelée Aerosol Age a même suggéré de Rowland qu’il était... un agent du KGB!
Mais de 1974 à 1985, l’accueil n’avait pas été enthousiaste non plus du côté de la communauté scientifique. «Le territoire était si nouveau que la plupart des scientifiques avaient le sentiment qu’ils ne savaient pas de quoi ceux-là parlaient», raconte Ralph Cicerone, président de l’Académie nationale des sciences, un des nombreux scientifiques à avoir rendu hommage à Rowland cette semaine.
Dans son communiqué, l’Université de Californie cite un commentaire fait par Rowland en 1997, à la Maison-Blanche, lors d’une table-ronde sur les changements climatiques:
Est-il suffisant pour un scientifique de simplement publier une recherche? N’est-ce pas la responsabilité du scientifique, si vous croyez avoir trouvé quelque chose qui peut affecter l’environnement, n’est-ce pas votre responsabilité que d’actuellement faire quelque chose, suffisamment pour qu’une action prenne place? Si ce n’est pas nous, qui? Si ce n’est pas maintenant, quand?