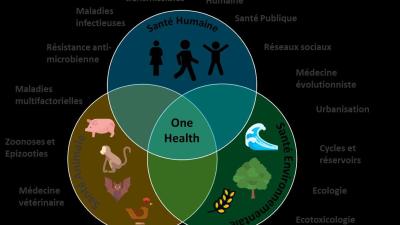De plus, la tendance à ne publier que des résultats positifs (qui diable veut perdre son temps à rédiger une étude arrivée à des résultats négatifs?) amplifie le problème, écrit une équipe d’épidémiologistes grec et américains dans une analyse de diverses études publiées au fil des années.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Rien de nouveau jusque-là : plusieurs travaux critiques du genre ont été publiés depuis une décennie. Sauf que ces chercheurs ont franchi un pas de plus en appliquant à leur analyse le vocabulaire de la finance —rareté artificielle, oligopoles, etc. Il en ressort que plus une étude est « révolutionnaire », plus le risque est élevé d’apprendre que ses auteurs ont monté en épingle leurs résultats. Ou bien, en langage économique, plus les enchères sont élevées et plus le « gagnant » risque d’avoir misé plus que la valeur réelle.
Parue dans la revue électronique Public Library of Science Medicine, l’étude dirigée par John Ioannidis, de l’École de médecine Ioannina, en Grèce, pointe en effet un risque soulevé ailleurs et en d’autres mots : l’intense compétition amène la tentation de publier trop vite, et la surabondance d’informations conduit à accorder une importance démesurée aux publications dites « prestigieuses ».
Dans la première situation —l’intense compétition— deux exemples récents : sur les cellules souches et sur les téléphones cellulaires. Dans la deuxième —des revues prestigieuses qui ont voulu publier trop vite une recherche apparemment exceptionnelle— le Dr Hwang Woo-Suk, de l’Universié nationale de Séoul, et sa falsification des données sur le clonage de cellules (lire Comment la fraude a pu passer entre les mailles du filet).
L’équipe de l’École de médecine Ioannina, en Grèce, responsable de l’analyse critique dont il est question ici, s’appuie toutefois sur un petit échantillon : elle n’a suivi le parcours que de 49 études médicales parues entre 1990 et 2004 citées par la suite plus de 1000 fois. Mais elle alimente un débat en cours dans la communauté scientifique, sur la tyrannie du « facteur d’impact » : cette course à la publication, non seulement le plus vite possible (« publier ou périr ») mais dans des revues qui feront le plus jaser. Personne n’a le temps de tout lire et que le flot de recherches scientifiques en mal de lecteurs continue de s’accroître...
Accessoirement, cette analyse, de même qu’un éditorial antérieur de John Ioannidis, ont aussi été réutilisés par les promoteurs des pseudo-sciences, qui y voient la « preuve » que les sciences dont les conclusions leur déplaisent ont toujours tort.
Parmi les recommandations de l’équipe d’Ioannidis : alléger la sacro-sainte sélectivité qui est au coeur de la réputation des revues comme Nature et Science, encourager la publication des résultats négatifs, et surtout, un effort concerté vers une publication intégrale sur le web (ce qui est, incidemment, la raison d’être de l’éditeur Public Library of Science : accès gratuit à l’information scientifique); si tout est à la portée d’un clic, les distorsions sont atténuées.
« Je pense que c’est déjà commencé », commente le neurologue Jake Young sur son blogue. À propos des articles parus dans Science ou Nature : « Je pense que la plupart d’entre nous portons attention à ces articles, mais avec un très fort scepticisme. Malheureusement, ce n’est pas souvent le cas dans la presse grand public —ce qui est la moitié de la raison pour laquelle j’écris ce blogue. »