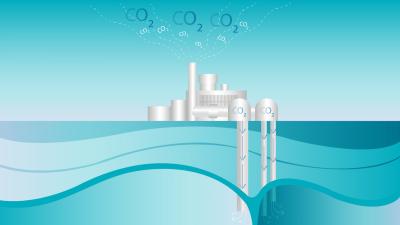« Je cours des risques si je parle aux journalistes, je n’ai pas de permission », admet Peter Ross, qui ne s’est pourtant pas privé de parler : en mai et juin, on a pu le lire et l’entendre dans plusieurs médias, francophones et anglophones. Et si les journalistes scientifiques sont nombreux à se tourner vers lui, c’est parce qu’il est à peu près le seul.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
« Avant [les nouvelles directives], je faisais l’entrevue et après, j’envoyais un courriel à mon agent de communication pour indiquer que je viens de parler avec X, sur le sujet Y. Mais maintenant, si je reçois un appel, je dis au journaliste, faut que je demande la permission. Et il y a toute une bureaucratie impliquée [qui remonte] jusqu’au directeur des communications du bureau du premier ministre, si j’ai bien compris. »
Peter S. Ross est un expert des mammifères marins et des contaminants au ministère canadien des Pêches et océans, en Colombie-Britannique. En mai, il a appris que son poste allait disparaître, en même temps que « la totalité du programme de recherche sur les contaminants ».
Les directives plus sévères auxquelles Ross fait allusion ont parfois donné lieu à des situations loufoques, comme ce journaliste du Ottawa Citizen dont la demande d’informations purement factuelles sur une collaboration canado-américaine à une recherche de la NASA est passée, à Ottawa, par 11 fonctionnaires en deux jours... mais n’a pris que 15 minutes à la NASA.
C’est dans ce contexte que deux associations de rédacteurs scientifiques, l’anglophone CSWA et la francophone ACS, ont lancé en février une campagne pour dénoncer le « musellement » des scientifiques à l’emploi du gouvernement canadien. L’association regroupant ceux-ci, l’Institut professionnel de la fonction publique, dénonce cette situation depuis 2010.
Mais reste que ceux qui en parlent ouvertement se retrouvent davantage à l’extérieur qu’à l’intérieur : par exemple, Jean Piuze, retraité de Pêches et Océans, qui a publié le 13 juin une lettre dans Le Devoir sur ce qu’il a appelé « L’aversion conservatrice de la science gouvernementale ».
Le silence autour des coupes dans la recherche est d’autant plus gênant qu’elles touchent des secteurs importants pour la santé (surveillance de la pollution chimique des eaux, impact des pesticides dans l’aquaculture, etc.) et au moins une est unique en son genre à l’échelle mondiale : celle connue sous le nom de Région des lacs expérimentaux (ELA), qui doit fermer en 2013. Elle « était à l’écologie ce que le super-accélérateur de particules est à la physique », écrivait le 23 mai le journaliste spécialiste de l’énergie Andrew Nikiforuk.
ELA est en fait un ensemble de 58 lacs où, depuis 1968, le travail mené par des scientifiques de plusieurs disciplines a permis (pour, récemment, environ 2 millions$ par année) de mieux comprendre les éclosions de cyanohactéries (ces algues de plus en plus omniprésentes dans les lacs et cours d’eau), l’impact des perturbateurs endocriniens ou les effets des changements climatiques sur la vie marine.
Même la revue britannique Nature a protesté, le 21 mai, devant la fermeture imminente de l’ELA, de même que des scientifiques israéliens et suédois. Une pétition « Save ELA » a récolté 11 500 signatures ce printemps, dont près de 3000 à l’étranger.
Et l’idée que ça puisse être récupéré par l’entreprise privée fait sourire Peter Ross. « Le gouvernement a annoncé très publiquement qu’il envisageait ce scénario, où un genre de recherche et de surveillance pouvait continuer », à travers les universités et l’entreprise privée. « Je veux qu’on m’explique comment on peut imaginer qu’un secteur industriel, ou bien le système académique, pourrait prendre la responsabilité des 88 000 produits chimiques sur le marché au Canada. »
Le secteur industriel, poursuit-il, pourrait en prendre une partie sous son aile, là où il y a un bénéfice à retirer. « Mais certainement pas la pollution chimique des océans! »
Craint-il un exode des jeunes chercheurs canadiens vers les États-Unis si proches? « Ce que je crains qu’on perde, c’est l’idéalisme et le futur de jeunes chercheurs, qui sont en train de décider s’ils devraient faire ou non un post-doc, s’ils devraient investir ou non leurs énergies dans un futur qui n’est plus. Il y a beaucoup de gens intéressés à protéger l’environnement et les ressources naturelles, mais ce que je crains, c’est que les jeunes vont abandonner avant même d’avoir commencé. »