Soixante-quatre romans. C'est l'équivalent
de Balzac et, pour les admirateurs de Jules Verne (1828-1905),
dont on célèbre cette semaine le centenaire
de la mort, son influence équivaut rien de moins
qu'à celle de Balzac. Et pourtant, parmi ces 64 romans,
tous n'ont pas traversé également les générations.
Des millions de personnes ont lu Voyage
au centre de la Terre (1864), ou Les Enfants du capitaine
Grant (1867), ou Vingt mille lieues sous les mers
(1870), ou Le tour du monde en 80 jours (1873), ou
L'Ile mystérieuse (1874) ou Michel Strogoff
(1876). Mais qui a lu Le Chancellor (1875), Le
Superbe Orénoque (1898) ou Bourses de voyage
(1903)?
Bien avant 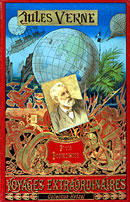 d'être
scientifiques, ces romans ne sont pas réunis sous
l'étiquette Voyages extraordinaires pour rien:
ils s'inscrivent dans la tradition d'un roman d'aventure
propre au XIXe siècle, le roman géographique.
Des récits où un héros explore courageusement
une contrée inconnue, ou combat des forces cachées
depuis la nuit des temps –tantôt une civilisation
oubliée, tantôt des survivants des dinosaures.
d'être
scientifiques, ces romans ne sont pas réunis sous
l'étiquette Voyages extraordinaires pour rien:
ils s'inscrivent dans la tradition d'un roman d'aventure
propre au XIXe siècle, le roman géographique.
Des récits où un héros explore courageusement
une contrée inconnue, ou combat des forces cachées
depuis la nuit des temps –tantôt une civilisation
oubliée, tantôt des survivants des dinosaures.
Verne y ajoute toutefois une couche qui fera
toute la différence: les descriptions. Ses personnages
sont souvent unidimensionnels –les bons contre les
méchants, écrit
un de ses admirateurs, Michel Tournier, de l'Académie
Goncourt. Mais son souci du réalisme transparaît
dans ses descriptions. Tout devient prétexte à
insuffler à ces récits un maximum de réalisme.
Description des lieux, des animaux, des horaires de trains...
et de la science. La science n'est en effet pour lui qu'un
élément parmi d'autres pour rendre crédibles
certaines de ses histoires. Et c'est grâce à
cet élément de plus, grâce à
ce souci de réalisme qui le caractérisait,
qu'il crée sans le savoir une nouvelle branche de
la littérature: la science-fiction.
Dans le monde anglo-saxon, les amateurs connaissent
davantage l'autre pionnier de la science-fiction, H.G. Wells
(La guerre des mondes, La machine à voyager dans
le temps, etc.), qui n'arrive dans l'univers littéraire
que dans les années 1890. Mais de nombreux écrivains
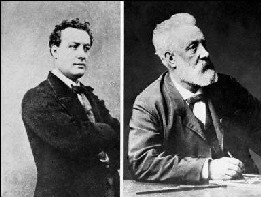 célèbres
du genre, comme les Américains Ray Bradbury et Isaac
Asimov à partir des années 1940, se sont fréquemment
réclamés de l'influence de Jules Verne.
célèbres
du genre, comme les Américains Ray Bradbury et Isaac
Asimov à partir des années 1940, se sont fréquemment
réclamés de l'influence de Jules Verne.
Foi en la science
Le dernier tiers du XIXe siècle, cette
époque où Verne ajoute la science à
son bagage littéraire, c'est l'époque d'une
foi en la science. Une foi, plus précisément,
dans un mot-magique: "progrès". En témoigne
notamment:
- le Nautilus, le sous-marin du capitaine
Nemo, qui est d'abord et avant tout un instrument d'exploration,
de découverte, un outil d'une beauté presque
exclusivement scientifique. Vision rassurante. Mais un
brin naïve, quand on se rappelle qu'une génération
plus tard, au XXe siècle, le tout premier usage
du sous-marin, ce sera... la guerre.
- Kaw-Djer, l'anarchiste de En Magellanie,
préside une colonie située au large de la
Terre de Feu qui n'est rien de moins qu'une république
idéale –dans la tradition du roman utopique,
écrit
Jean-Paul Dekiss, le plus récent des nombreux biographes
de Verne.
- Phileas Fogg est le modèle même
de la pensée pure: son analyse de l'horaire des
trains et des bateaux lui permet, sans jamais avoir franchi
le pas de sa porte, de parier qu'il soit possible de faire
le tour du monde en 80 jours. Dans son monde en
effet, les trains arrivent toujours à l'heure et
les ennuis mécaniques semblent relever d'une autre
époque. Seules les intempéries et les imparfaits
humains sont dignes de se mettre en travers de cette pensée
pure.
- Cyrus Smith, l'ingénieur, le
"savant" de L'Ile mystérieuse, est la clef
de voûte qui permet aux naufragés de non
seulement s'adapter à leur île, mais encore
de bâtir une colonie rien de moins que prospère.
Cette foi inébranlable en la science
est au cœur des expositions universelles de la fin
du XIXe et du début du XXe siècle. Elle est
toujours bien présente lorsque la science-fiction
américaine démarre sur les chapeaux de roues,
dans les années 1920. Il faudra une crise économique,
une deuxième guerre mondiale et une bombe atomique
pour la voir partir en fumée.
Un Jules Verne serait donc impensable en 2005.
Il était un produit de son époque, et bien
que certaines de ses œuvres plaisent encore (90 000
exemplaires vendus en 2004pour les seuls 18 livres de chez
Hachette), les adultes qui veulent se projeter dans le futur
puisent davantage dans des imaginaires d'auteurs faits de
catastrophes écologiques, d'accidents génétiques
ou de technologies imparfaites. A vingt mille lieues du
Nautilus.
Pascal Lapointe
Photos: Centre international
Jules Verne
