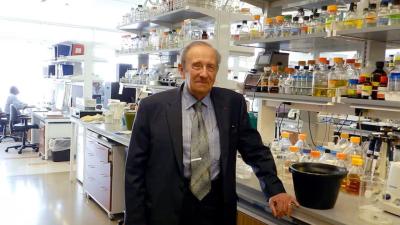1. La « fracturation » de la roche, pour en extraire le gaz, peut-elle contribuer à contaminer l’eau?
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Réponse : à première vue peu probable, mais on ne sait pas.
De toutes les zones d’ombre, c’est celle dont les médias ont le moins parlé, mais qui serait la plus lourde de conséquences. Le scénario : une compagnie fracture la roche à plus de 1000 mètres de profondeur pour en extraire le gaz. Ces fractures peuvent-elles en entraîner d’autres, permettant aux produits toxiques d’atteindre la nappe d’eau souterraine qui alimente toutes les villes de la région?
Quelques géologues ont évoqué un chiffre depuis deux semaines : « une centaine de mètres ». Ce serait le maximum que pourrait atteindre une fracture dans ces profondeurs. Cela, parce que la « recette chimique » employée pour fracturer la roche est censée être calculée en fonction « des propriétés spécifiques à chaque formation de schiste et, dans une certaine mesure, à chaque puits », écrivent Mark Zoback et ses collègues dans un rapport du Worldwatch Institute publié en juillet.
Mais le problème est que ces estimations proviennent de simulations parfois vieilles de 10 ans. Il n’y a jamais eu de véritables suivis géologiques à de telles profondeurs et dans ce type de roche. Les micro-séismes provoqués par la fracturation n’ont été analysés aux États-Unis que dans 3% des cas en 2009. « C’est un domaine où il n’y a pratiquement aucune recherche », s’est plaint l’hydrogéologue Geoffrey Thyne, du Colorado, auteur de l’étude qui a permis d’établir, en 2008, que des émanations de méthane dans le comté de Garfield provenaient de la couche géologique d’où était extrait le gaz de schiste (voir De l’eau dans le gaz).
2. Connaît-on les produits chimiques utilisés par l’industrie?
Réponse : oui, mais.
Une étude de l’État de New York, en 2009, en a identifié 260. Une scientifique à la retraite du Colorado, Theo Colborn, en a énuméré un millier. En août 2009, un porte-parole de la compagnie albertaine EnCana affirmait que sa compagnie était prête à dévoiler ces informations. Et au Québec la semaine dernière, une autre compagnie albertaine, Questerre, publiait une liste de 12 produits.
3. Connaît-on la concentration de ces produits?
Réponse : non.
Une liste de produits n’est d’aucune utilité si on n’en connaît pas la concentration. Ainsi, bien des poisons ont de tout temps été présents à l’état naturel tout autour de nous, mais dans des concentrations trop faibles pour mettre la vie de quiconque en danger.
Les compagnies seront-elles plus transparentes d’ici au 9 octobre, date limite pour répondre à la demande de l’Agence américaine de protection de l’environnement de dévoiler leur recette chimique? Ce sera à suivre.
4. Combien d’eau contaminée par ces produits remonte à la surface?
Réponse : on ne sait pas.
Une fracturation consiste à injecter 10 millions de litres d’eau là-dessous, auxquels se mêle cette mystérieuse soupe chimique. La roche ainsi fracturée évacue son gaz naturel qui remonte alors par le puits de forage, avec une grande quantité de cette eau (ou plutôt, désormais, de la boue!).
Quel pourcentage remonte? 15%, dans les puits de la strate Marcellus (nord-est des États-Unis) selon une enquête du magazine ProPublica en décembre 2009. Jusqu’à 40% selon l’Agence américaine de protection de l’environnement en 2004 (une enquête qui avait été critiquée pour sa connivence avec l’industrie). Entre 30 et 70% selon le ministère américain de l’Énergie en 2009.
Prenons l’hypothèse conservatrice : 15%. Si 10 millions de litres ont été injectés dans un puits, ça veut dire qu’un million et demi de litres sont remontés : c’est de l’eau désormais contaminée, par les additifs chimiques de l’industrie, par une plus grande concentration de sel et parfois par des contaminants naturels, comme l’arsenic, voire faiblement radioactifs. Il faut donc s’en débarrasser (voir le texte précédent), ce qui veut dire la transporter ailleurs.
Un camion-citerne à grande capacité peut transporter 15 000 litres. Un tel puits nécessite donc 100 voyages de grands camions-citernes après chaque fracturation... et cinq à six fois plus pour livrer l’eau nécessaire à chaque nouvelle fracturation. Rien que dans l’État de New York, avant le moratoire voté le 4 août, les autorités locales estimaient qu’il y aurait bientôt 1500 puits par année. D’ici 2012, l’industrie du gaz naturel avançait le chiffre de 32 000 puits par an sur l’ensemble du territoire américain. Cela veut dire, dans l’hypothèse conservatrice, des dizaines de milliards de litres d’eau contaminée par an, qu’il faut enfouir quelque part ou envoyer à une usine d’épuration.
5. Combien d’eau contaminée par ces additifs chimiques reste sous la terre?
Réponse : on ne sait pas.
Forcément, du pourcentage de l’eau qui remonte, découle le pourcentage d’eau qui reste là-dessous. C’est d’autant plus important que si cette eau contient 0,5% de ces mystérieux additifs chimiques, cela représente, toujours selon l’hypothèse conservatrice, plus de 40 000 litres d’additifs par fracturation. Or, toute cette soupe ne restera pas éternellement à plus de 1000 mètres de profondeur. Même si l’idée d’une fracturation catastrophique (celle évoquée à la question 1) s’avérait non fondée, les produits toxiques finiraient par trouver leur chemin, après des années ou des siècles. Combien de temps leur faut-il pour être dégradés ou assimilés par des bactéries? On ne le sait pas non plus.
6. Le gaz de schiste émet-il moins de gaz à effet de serre que le charbon ou le pétrole?
Réponse : ça dépend de ce qu’on calcule.
Au départ, le bilan est positif, parce que brûlé, le gaz de schiste émet deux fois moins de dioxyde de carbone que le charbon et produit moins de polluants responsables du smog.
Mais ça se complique dès qu’on fait intervenir un des concepts préférés des études environnementales : le cycle de vie. Cela veut dire qu’il faut prendre en compte les autres étapes indispensables à la production du gaz de schiste. Par exemple, les gaz à effet de serre émis par des centaines de voyages de camions-citernes pour chaque puits et pour chaque fracturation, en plus des routes et des infrastructures à construire pour chaque puits.
Personne n’a pu faire une évaluation fiable du cycle de vie, faute d’avoir en main toutes les réponses aux cinq autres questions.