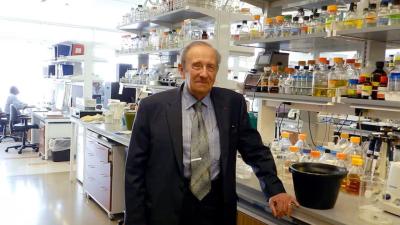Le 29 avril, le directeur du principal organisme subventionnaire de la recherche en santé mentale au monde, le NIMH aux États-Unis, annonçait une réorientation des priorités de recherche «au-delà des catégories» des maladies mentales telles que les définit le DSM-5 —Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, cinquième édition. Le 13 mai, la Société britannique des psychologues se fendait d’un jugement similaire.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Le DSM est, depuis des décennies, l’ouvrage de référence en psychiatrie pour catégoriser ce qu’est une maladie mentale. La préparation de la 5e édition —14 ans après la précécente— a provoqué depuis trois ans des discussions houleuses, autour de deux principaux problèmes: la croissance anormalement rapide du nombre de «maladies» d’une édition à l’autre et le caractère subjectif des définitions.
Or, si la prise de position de l’Institut américain a été interprétée comme un appel aux psychiatres à changer leur pratique, il s’agit en réalité d’un appel qui s’adresse aux chercheurs. Parce que le NIMH est un organisme subventionnant de la recherche, il n’a pas le pouvoir de changer la façon dont les psychiatres pratiquent, mais il peut pointer les fausses pistes suivies par la recherche: et c’est là que se situe son désaveu du DSM-5. Autrement dit, le NIMH souhaite que la recherche ne se limite plus au carcan imposé par la classification du DSM, et si ce désir d’ouvrir de nouvelles pistes s’avère fructueux, les retombées se feront sentir un jour dans les cliniques.
«C’est pour le futur, plutôt que pour tout de suite», résumait dans le New Scientist le psychiatre britannique Simon Wessely.
Le NIMH promeut par exemple un prototype, le Research Domain Criteria Project (RDoC), qui tente d’établir des critères diagnostics qui s’appuieraient davantage sur des données biologiques ou neurologiques que sur la seule observation des symptômes.
De Freud aux neurones
Les racines du problème qu’expriment ces critiques sont en partie... freudiennes. Exprimées au début du 20e siècle, les théories voulant que les maladies mentales soient le résultat d’un dysfonctionnement de notre «inconscient», ont été assez tenaces pour durer jusqu’à la première édition du DSM, en 1952.
Tantôt intrigantes, tantôt contestables, elles n’en restaient pas moins des théories, de sorte qu’au fil des générations, s’est imposée l’idée de les asseoir sur des faits plus solides. Et pendant la majeure partie du 20e siècle, les faits solides n’ont pu provenir que d’une seule source: l’observation des symptômes des patients. Par l’accumulation des observations, psychologues et psychiatres ont tenté de dégager des tendances, puis des catégories et, à partir de là, des traitements.
Ce qui était déjà mieux qu’avant: davantage de précision dans les descriptions. En contrepartie, c’était dangereusement subjectif. Les éditions III (1980), IV (1994) et V (2013) du DSM en témoignent: une multiplication du nombre de «maladies». De 106 troubles mentaux et 130 pages dans la première édition, on est passé à 350 dans la 4e édition... et 1000 pages. Avec pour résultat qu’un nombre croissant de patients se sont mis à être étiquetés de symptômes correspondant à plus d’une maladie... incluant des diagnostics différents d’un psychiatre à l’autre.
Les progrès rapides de la génétique et de la neurologie, à partir des années 1990, ont ouvert la porte à la perspective de faits plus solides: pourrait-il exister des gènes associés à une maladie mentale? Des surplus ou des déficits d’une protéine? Des anomalies dans les connexions entre les neurones? La recherche «du» gène de ceci et de cela a été aujourd’hui écartée comme trop simpliste, mais les autres quêtes ne font que commencer.
Revoir les catégories
Et certaines de ces quêtes tendent à confirmer l’idée que cette classification rigide des maladies mentales est désuète. L’imagerie par résonance magnétique par exemple, a révélé l’an dernier que la même région du cerveau s’active de la même façon dans les cas appelés troubles de l’anxiété et troubles de l’humeur. En février dernier, dans une étude à grande échelle —33 000 personnes diagnostiquées avec cinq des principaux troubles mentaux— quatre fragments d’ADN se sont révélé être associés aux cinq troubles.
Pour reprendre une analogie du journaliste David Adam, dans Nature :
Le modèle à suivre n’est plus Freud, mais la révolution génétique qui prend place en oncologie. Là-bas, chercheurs et médecins commencent à classifier et traiter les cancers sur la base du profil génétique d’une tumeur, plutôt qu’en fonction de la partie du corps où elle grossit.
Cartographier le cerveau
Reste qu’il y a du chemin à faire. On ne s’en doutait pas au temps de Freud, mais le cerveau s’avère un organe d’une incroyable complexité. L’opinion publique en a eu une petite idée plus tôt cette année, lorsque deux méga-projets de recherche voués à s’étaler sur au moins une décennie ont été annoncés, l’un aux États-Unis, l’autre en Europe. Avec le même objectif dans les deux cas: dresser une carte de ce qui clignote entre nos deux oreilles. Mais personne, dans la communauté des neurosciences, ne semble croire qu’une seule décennie suffira à dresser cette carte: on n’est même pas sûr de réussir à dresser celle du cerveau d’une souris d’ici 10 ans!
Cette prise de conscience explique en partie que les compagnies pharmaceutiques —dont les liens avec le DSM sont pourtant régulièrement décriés— aient considérablement ralenti la production de nouveaux médicaments pour des maladies mentales: il devient beaucoup plus coûteux qu’avant d’essayer de développer un médicament capable de cibler la cause d’une pathologie, à mesure qu’on prend justement conscience de la complexité des cibles.
Résultat, la recherche sur les causes des maladies mentales est en train d’effectuer un virage, mais ce n’est pas le genre de virage qui peut se négocier très vite. De ce point de vue, résumait le 11 mai un éditorial du New York Times , le Manuel diagnostic des maladies mentales n’est pas si mauvais qu’il en a l’air, tant qu’il est utilisé comme un outil pour guider les professionnels, et non une fin en soi.
Même l’un des plus virulents critiques du DSM, le Dr Allen Frances, lui trouve des qualités:
Le concept de schizophrénie reste une construction extrêmement utile —imparfaite, oui, mais très utile dans la communication clinique et dans le choix de traitements. Les troubles définis par le DSM sont tous des constructions faillibles et subjectives, mais la plupart sont nécessaires à titre de balises temporaires, jusqu’à ce que nous apprenions à en développer de meilleures.
Et selon Nature, l’édition 5 comporte dans son titre une petite révolution: si ses auteurs ne l’appellent plus le DSM-V mais le DSM-5, c’est pour ouvrir la porte à des révisions qui, cette fois, ne prendront plus 14 ans. L’éditeur annonçait en effet en 2011 qu’on verra apparaître en quelque sorte, en ligne, des éditions 5.1, 5.2 et ainsi de suite, en fonction de ce que notre cerveau voudra bien révéler comme secrets.