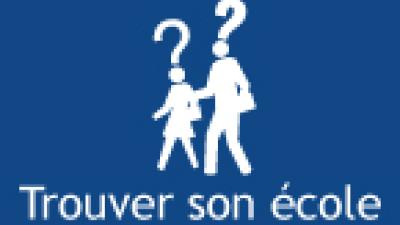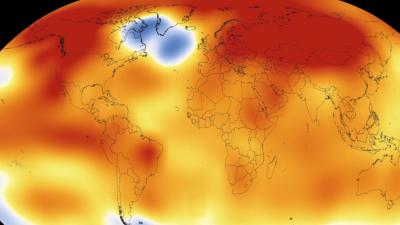Les Jésuites avaient alors baptisé le cours d’eau situé au nord de l’Île Jésus «rivière Saint-Jean». Et son histoire géologique, elle, remonte à plusieurs milliers d’années.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Comme l’explique Nicolas Chatel-Launay, interprète au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, le Québec était recouvert d’une couche de glace de 3 km d’épaisseur il y a de cela environ 14 000 ans.
Ce glacier a commencé à fondre 2000 ans plus tard. « Lorsqu’un glacier fond, il se déplace et arrache de la terre et de la roche, laissant derrière lui des résidus. Ces dépôts ont formé une couche d’argile qui constitue la base de tout le terrain dans le sud du Québec et la région des Grands Lacs », raconte le naturaliste.
Lorsque la glace a fondu, le terrain s’est retrouvé sous le niveau de la mer. L’eau salée a pénétré le continent et a formé la mer de Champlain. Suite au retrait du glacier, tel un matelas qui rebondit après avoir épousé la forme d’une personne, la roche a fait la même chose... sauf que le processus prend des milliers d’années! « Il y a 9000 ans, l’eau salée a été remplacée par de l’eau douce pour former un lac que l’on nomme Lac Lampsilis », raconte Nicolas Chatel-Launey.
Ce lavage a du même coup supprimé le lien chimique qui liait la glaise et le sel que l’on retrouvait au fond de la mer de Champlain. « C’est ce qui explique que nous nous trouvons sur des terres instables ». Environ 4500 ans plus tard, l’eau s’est retirée et il nous est resté certaines grandes voies d’eau comme le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles.
Cependant, ces voies d’eau sont très peu profondes. « Nous n’avons pas ici de grandes rivières qui ont creusé leur lit. Ce sont des plaines de fond de lac, où l’eau a descendu », poursuit Nicolas Chatel-Launey. En effet, la rivière des Mille-Îles, en temps normal, fait 1 mètre de profondeur en moyenne. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a fallu creuser des voies maritimes dans la rivière pour que les bateaux à moteur puisse passer.
Dans le Québec d’avant 1850, l’endroit était populaire pour la traite des fourrures en raison de la présence, entre autres, de castors et de rats musqués. La rivière a été par la suite une voie de communication exceptionnelle pour monter vers la rivière des Outaouais, car il n’y avait que deux portages à faire.
Aujourd’hui, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles regroupe dix îles couvrant 26,2 hectares de terres privées appartenant aux villes de Laval et de Rosemère et à l’organisme Éco-Nature, en plus de bénéficier du statut de «Refuge faunique».
Par Marie-Eve Cloutier – Agence Science-Presse