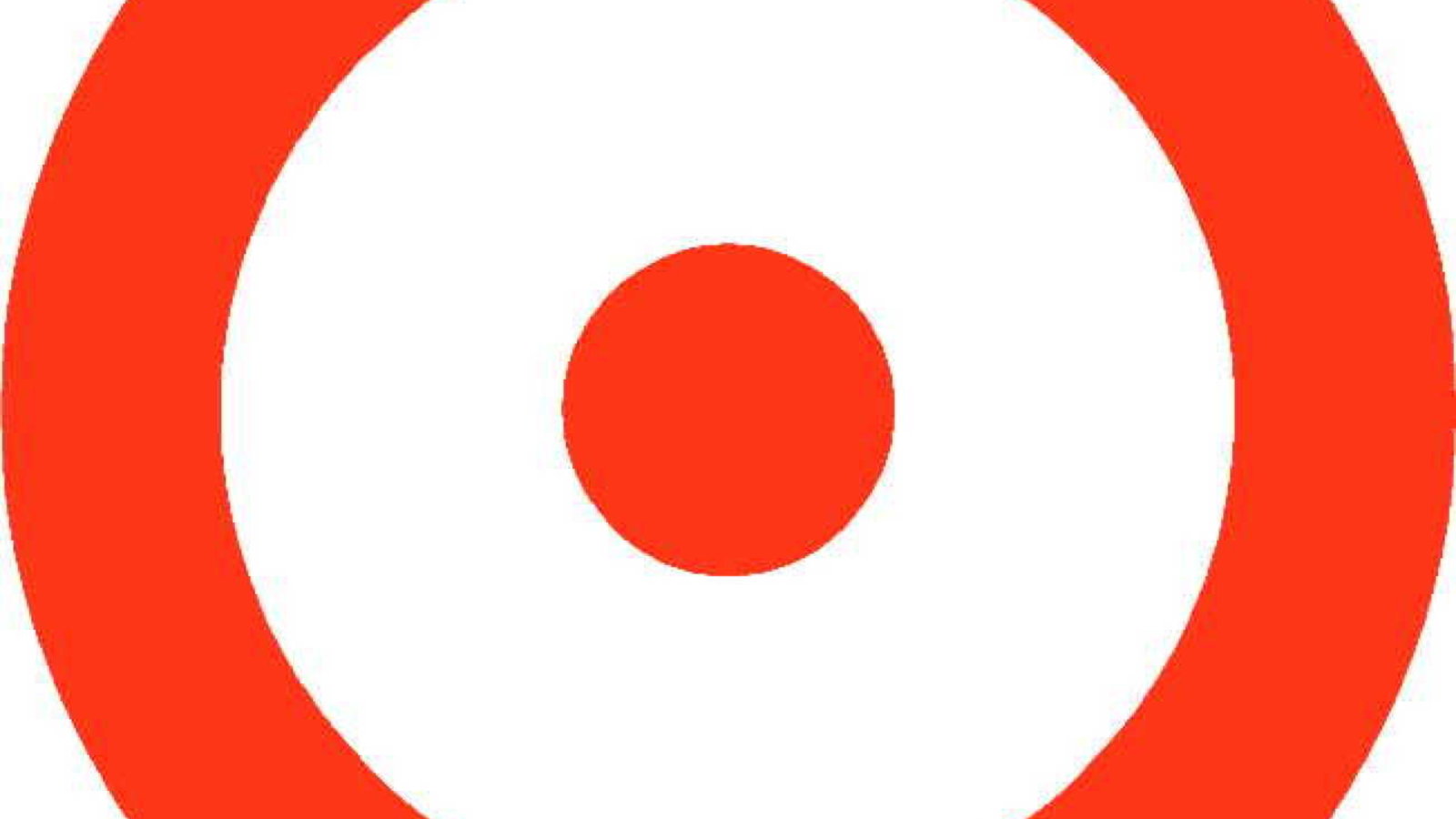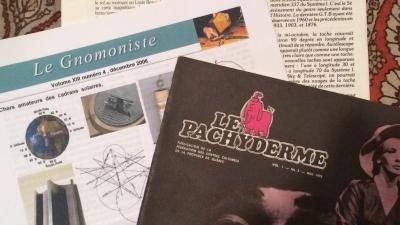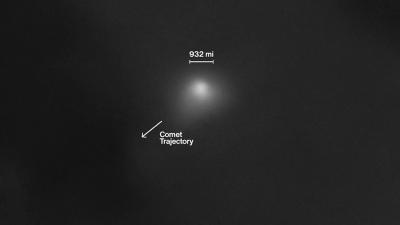6) Quatre projets sauveteurs
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Un billard dans l’espace!
On a construit un billard dans l’espace. Laissez-nous vous expliquer. C’est une machine qui contient un aimant et un ressort. Cette machine sera placée à proximité de la Terre. Grâce à l’aimant, notre appareil va attirer une petite météorite et la repousser à l’aide du ressort vers l’astéroïde menaçant la Terre. Quand la météorite va se déposer sur notre appareil, elle va déclencher le ressort qui va l’envoyer directement sur l’astéroïde, le faire changer de trajectoire et l’empêcher de toucher la Terre. Comment ça fonctionne? Quand on prend un ressort et qu’on l’écrase, il reprend sa forme initiale lorsqu’on le relâche. Lorsqu’il va reprendre sa forme, il va exercer une poussée sur la météorite ce qui va la projeter sur l’astéroïde et faire dévier sa trajectoire. Ainsi, la Terre sera saine et sauve.
Un petit coup de peinture
En nous servant de la couleur blanche qui a comme propriété de réfléchir la lumière du Soleil, nous allons à l’aide de notre vaisseau envoyer de la peinture blanche sur l’astéroïde. Puisqu’un astéroïde est assez gros et qu’il va recevoir une quantité de lumière solaire assez importante, la réflexion de cette lumière devrait exercer une poussée suffisante sur l’astéroïde pour dévier sa trajectoire et l’empêcher de frapper la Terre.
Fondre au soleil
On va vous présenter notre satellite qui va faire fondre la comète composée de glace et d’un peu de poussières. Notre satellite sera équipé d’un panneau solaire qui sera orienté de façon à recevoir les rayons du Soleil et à les réfléchir (ou les renvoyer) vers la comète. Les rayons ainsi réfléchis vers la comète vont la faire fondre et elle ne se rendra pas jusqu’à la Terre qui sera ainsi sauvée.
Souffler sur l’astéroïde
Nous allons vous présenter notre vaisseau « WMKIB-51 ». Le principe de notre vaisseau est d’envoyer du « Coca-Cola » avec des « Mentos » vers l’astéroïde. Le but est en fait de lancer un objet qui explosera près de l’astéroïde pour le faire changer de trajectoire en exerçant une poussée sur lui suite à l’explosion causée par le mélange du Coca-Cola avec les Mentos. Nous nous sommes dit que le Coca-Cola pourrait faire l’affaire, car il contient du gaz. Notre vaisseau contient 2 compartiments : un pour le Coca-Cola et un autre pour les Mentos. Pour finir, la Terre sera sauvée et aucun morceau de l’astéroïde ne la touchera. Une trajectoire est un chemin que l’on prend du point A à un point B. Dans ce cas-ci, l’astéroïde est au point A et la Terre est au point B.
Vous pouvez visionner les photos en 3D sur le site http://www.jeanpierreurbain.info
*****
5) Chantiers en cours…
Lors de sa 5e visite, M. Urbain est venu nous guider pour la réalisation de nos maquettes. Nous étions placés en équipes de 4 ou 5 élèves et nous avions 4 scénarios différents à réaliser. Nous avions fait des croquis avant la visite de M. Urbain pour nous aider à construire nos vaisseaux. Grâce à nos croquis, nous avons pu poser des questions à M. Urbain et lui demander des conseils. Comme chaque équipe avait une stratégie d’évitement différente, nous ne pouvions pas consulter les équipes voisines. Le travail en équipe s’est bien déroulé dans certaines équipes. Dans d’autres équipes, c’était plus difficile. Ce n’est pas toujours facile la coopération! Si une véritable menace met en danger notre planète un jour, ce sera tout un défi de travailler tous ensemble pour sauver la Terre! Une chance que M. Urbain et notre enseignante étaient là pour nous aider à réaliser notre projet!
*****
4) Trucs pour l’observation des étoiles filantes
Lors de sa 4e visite, Jean-Pierre Urbain nous a donné des trucs pour mieux observer les étoiles. Pour observer les étoiles, il est important de bien comprendre le fonctionnement de notre vision. C’est notre pupille qui nous permet de voir les photons ou grains de lumière. Dans le noir, notre pupille se dilate pour laisser passer un maximum de photons et le jour, c’est le contraire, notre pupille se contracte pour laisser passer juste assez de lumière pour voir et ne pas être ébloui ou aveuglé par une trop grande quantité de photons. Notre œil a besoin d’au moins 20 minutes pour s’ajuster dans le noir et c’est la même chose pour la lumière du jour. Pour pouvoir observer les étoiles, il faut une noirceur parfaite. Il faut éviter toute pollution lumineuse (surtout la lumière blanche), car la lumière désajuste nos yeux et nous empêche de bien voir les étoiles. Il n’y a que la lumière rouge qui ne désajuste pas notre vision. Lorsqu’il y a de la neige, il est facile de constater si des météorites sont tombées sur le sol. On peut également vérifier le contenu de nos gouttières. Parfois, on y trouve des petites météorites tombées du ciel.
En 1984, à Penouille en Gaspésie, un jeune collectionneur de cailloux a trouvé une petite météorite sur le bord d’une plage.
Pour vérifier si on est bien en présence d’une météorite, on peut utiliser un aimant pour voir si notre roche contient du fer, on peut également vérifier si les autres roches de la même taille ont la même masse et on peut regarder si on voit des traces de brûlures. Les météorites sont plus massives que les roches terrestres. De plus, elles contiennent presque toujours du fer. On voit souvent des traces de brûlures sur les météorites parce qu’elles brûlent lors de leur entrée dans notre atmosphère.
Nous avons tous des fragments de météorite dans nos poches, car une météorite est tombée il y a plusieurs millions d’années à Sudbury en Ontario. Cette météorite était surtout composée de nickel et d’autres métaux. Or, dans la fabrication de nos pièces de 5 cents, on utilise du nickel qui provient de la ville de Sudbury. C’est pour cela que nous transportons tous des petits morceaux de l’astéroïde tombé à Sudbury avec nous.
Au Canada, chaque fois que l’on trouve une météorite, on lui donne le nom du bureau de poste le plus près.
Nadège Thibodeau, groupe 51 (5e année)
*****
3) Nous avons crée des cratères
Lors de notre visite au planétarium Rio-Tinto Alcan, nous avons pu recréer des cratères d’impact grâce à une expérience que notre animateur Gwenn nous a fait faire avec des billes de métal, de la farine et du cacao. Nous avions 2 billes différentes pour remplacer les météorites : une petite et une grosse. Nous avons fait nos tests à trois hauteurs différentes : épaule, genou et escabeau. Nous devions mesurer le diamètre du cercle (cratère) formé lors de l’impact. Nous avons remarqué que la hauteur, la vitesse et la grosseur de l’impacteur (bille utilisée pour remplacer la météorite) avaient une influence sur la grosseur et la profondeur du cratère. Notre animateur M. Gwenn nous a aussi appris la différence entre une météorite qui est une roche qui tombe sur la Terre, un météore ou étoile filante qui est le phénomène lumineux qu’on observe depuis le sol dans l’espace et un météoroïde qui est une pierre qui voyage dans l’espace. Les météorites ne proviennent pas toutes d’un astéroïde. Elles peuvent provenir d’une planète ou d’une lune. M. Urbain était avec nous lui aussi pour nous apprendre des choses ! Il nous a expliqué que nos yeux nous donnent 2 images différentes qui sont réunies grâce à notre cerveau en une seule image nous permettant ainsi d’obtenir la perspective. L’étude des cratères d’impact sur une planète peut nous donner de l’information sur son âge et sur son histoire. La plupart des météorites contiennent du fer. Pour vérifier si notre roche provient vraiment d’une météorite, on peut donc utiliser un aimant. Si l’aimant est attiré vers la roche, elle contient donc du fer et on est probablement en présence d’une météorite. Le 15 février 2013, une météorite est tombée à Tcheliabinsk en Russie. À la même date, une autre météorite est tombée dans le lac de Tchebarkoul lui aussi en Russie. Cette énorme roche tombée dans le lac provenait de la même météorite tombée à Tcheliabinsk qui avait perdu des morceaux en entrant dans notre atmosphère. Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire et elle possède 67 lunes ! Les étoiles se forment dans les nébuleuses. La surface de la planète Mars contient beaucoup d’oxyde de fer. Le fer s’est oxydé alors c’est pour ça que le sol de Mars est rouge. On peut dire que Mars est une planète rouillée !
*****
2) Le poids d’une fusée fait 100 fois celui de son satellite
Le jeudi 6 février 2014, M. Jean-Pierre Urbain est venu nous visiter pour une deuxième fois. Nous avions hâte d’apprendre de nouvelles choses. Cette fois-ci, nous avons appris que la plupart des fusées ont 3 étages et qu’il y a 1 réservoir de carburant pour chaque étage. Les réservoirs se vident les uns après les autres et quand le réservoir d’un étage se vide, l’étage se détache de la fusée. Parfois, les étages tombent sur la Terre, mais c’est rare. Pour éviter que ça arrive, on lance les fusées près des océans. Comme ça, si un étage tombe, il tombera dans l’eau. Les étages de la fusée sont lourds lorsqu’ils sont remplis de carburant et légers quand ils se vident. C’est comme une canette de boisson gazeuse. Une fusée pèse 100 fois plus lourd que la charge utile qu’elle transporte. La première charge utile qui a été envoyée dans l’espace en 1957 s’appelle Spoutnik ce qui veut dire compagnon de route en russe. Le premier vaisseau habité à avoir été envoyé dans l’espace est le Vostok en 1961. C’est Iouri Gagarine qui le conduisait. Il a été choisi parce qu’après une expérience où on avait donné à tous ceux qui voulaient partir à bord du Vostok un médicament qui donnait mal à la tête, Iouri est le seul qui a avoué qu’il avait mal à la tête. La première femme envoyée dans l’espace est Valentina Terechkova en 1963. La Terre prend 24 heures pour tourner sur elle-même. Il y a trois types d’orbites autour de la Terre. Il y a les orbites proches (A), les orbites de garage (B) et les orbites géostationnaires (C). Les orbites géostationnaires sont très utiles pour les satellites de télécommunications. Il y a autant d’orbites que d’objets. La nourriture des premiers astronautes se trouve dans des tubes comme pour le dentifrice.
*****
1) Une catastrophe a donné naissance à la Lune
Nous avons appris par exemple que la Lune s'est formée à la suite d'un accident. Théa, une petite planète de la même grosseur que la planète Mars, est entrée en collision avec notre planète. Théa s'est brisée en petits morceaux et la Terre a elle aussi perdu quelques morceaux. Des morceaux de la Terre et de Théa ont été attirés les uns vers les autres ce qui a formé la Lune. La Lune ne tombe pas sur la Terre parce qu'elle tourne en orbite autour de notre planète. Certaines substances existant sur la Terre comme le fer proviennent de l'espace, donc des météorites ! Les dinosaures sont disparus à cause d'un astéroïde qui est tombé sur la Terre. De nombreuses catastrophes se sont produites et la lumière du Soleil a été bloquée par une épaisse couche de poussière. Cela a eu de graves conséquences sur la chaîne alimentaire, car les herbivores qui n'avaient plus rien à manger sont disparus et les carnivores qui mangeaient ces herbivores sont morts de faim. Il y a des aurores boréales de différentes couleurs, mais la couleur que l'on voit le plus souvent est le vert. La météorite d'Hoba qui est tombée en Afrique est tellement grosse qu'elle pèse 80 tonnes ! Comme elle est très lourde et que personne ne peut la soulever, les gens qui l'ont trouvée ont laissé Hoba sur place et c'est devenu un lieu touristique pour les nombreux curieux qui veulent la voir.