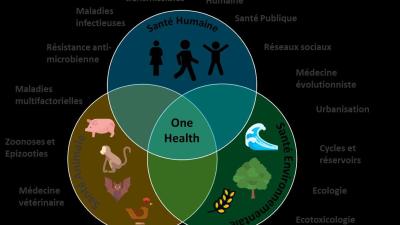Voilà pourquoi j’avais à mon agenda les Rendez-vous de la santé mentale, l’occasion de visiter les couloirs de l’Institut universitaire de santé mentale de Montréal – l’ancien « Louis-H Lafontaine » qui célèbre actuellement ses 140 ans - mais surtout d’emprunter trois « livres vivants », de m’entretenir avec trois personnes (ou plutôt quatre) qui vivent la maladie mentale au quotidien. Et d’apprendre à travers le regard qu’elles posent sur elles.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Bernard Saulnier, écrivain et patient. Il signe d’ailleurs "Les humeurs culturelles" sur le site de l’Institut universitaire de santé mentale. Patient et membre de Reprendre pouvoir, une association d’usagers-conseillers.
« Je souffre de schizophrénie paranoïde, je ne suis pas cette maladie. Je suis là pour démythifier cette maladie, pour dire aux gens qu’il y a quelque chose après, qu’il faut demander de l’aide, ne pas rester seul, que ce n’est pas terminal. Il y a moyen de vivre et de se rétablir. Je vis dans un appartement supervisé où un aidant est là 35 heures par semaine au cas où… je « décompense », je perd la réalité, je délire. C’est un moment éprouvant, très souffrant. On ne se voit pas malade. J’ai rencontré la maladie, j’avais 24 ans, c’était après un Symposium de sculpture monumentale où j’avais travaillé en compagnie d’artistes. C’était une période de grande exaltation. À la fin, je suis tombé. Jusqu’à la maladie. J’ai demandé de l’aide. J’ai été hospitalisé souvent et je suis remonté des bas-fonds. Pas tout seul, grâce à des fraternités, grâce à la foi, grâce à l’écriture. J’ai ma famille – je parle à ma mère, âgée de 83 ans, tous les jours – et des amis qui m’aident à dédramatiser les choses. Il y a moyen de composer avec la maladie. Un être humain, c’est perfectible. Je veux combattre les fausses idées qui circulent, souvent dans les médias, sur la schizophrénie. Ce n’est pas les histoires d’horreur que l’on lit dans les journaux. La maladie, c’est difficile mais le meilleur est à venir ».
Luc et Agnès Robillard, proches (parents)
« Nous avons vécu beaucoup d’isolement. Notre enfant était spécial. Le lien affectif ne s’est pas fait, il a été diagnostiqué autiste. On le voit comme un étranger, mais l’amour maternel prend le dessus. Les médecins nous ont dépeint son avenir : un appartement supervisé et un travail dans un atelier spécialisé. Nous nous sommes dit : pourquoi pas, cela lui fait un avenir. Mais le chemin a été différent. À l’hôpital où il était avant, on exigeait beaucoup trop de lui, on voulait en faire une personne normale. Il avait un comportement hors-norme : il empruntait les bougies dans les automobiles, ramasser tous les mégots et les balles de golf (une véritable passion), il collait son visage aux gens qui lui parlaient et il avait des crises de violence. Alors nous avons acheté un chalet dans le Nord pour l’emmener les fins de semaine, lors de ses sorties de l’hôpital. Nous nous sommes isolés des gens, des jugements. Notre fils était stigmatisé par la société et nous le sommes devenus en même temps que lui. Maintenant que notre fils a 47 ans et que nous vieillissons, nous avons des inquiétudes : la société aura-t-elle toujours une place pour lui, un « asile » au sens positif du terme. La tendance est de vider les hôpitaux psychiatriques qui deviennent des centres de recherche. Qu’en est-il aussi de la loi concernant les soins de fin de vie ? N’y a-t-il pas de pire souffrance que la souffrance mentale ? Nous avons pu compter sur des associations de parents pour nous soutenir. Nous avions des histoires communes à nous raconter, ce n’est pas toujours malheureux, on peut même en rire. Avec le recul, il nous a rendu heureux».
Étienne Boucher, infirmier clinicien
« Je travaille au programme des Troubles psychotiques, en réadaptation intensive. C’est la 3ème ligne. Les personnes que je rencontre ont entre 20 et 30 ans et souffrent de troubles psychotiques réfractaires. Ce sont des patients très atteints. Ils restent à l’hôpital durant 18 mois et on les prépare pour le retour en société, en appartement supervisé. On peut se rétablir de la maladie en suivant un cheminement clinique. Ce que je fais ce sont des « alliances thérapeutiques », je partage des choses au quotidien avec les patients, ce n’est pas une relation utilitaire - on se croise, se salue dans un climat égalitaire, nous entrons en relation. Je ne vois pas ça comme un travail ou une tâche. Je tisse un lien et une fois qu’existe ce lien, je tente de rattraper le client quand il va moins bien, de l’orienter dans la réalité sans confronter ce qu’il pense, car c’est pour lui « sa » réalité, ce qu’il vit. C’est la maladie qui a alors le contrôle. Nous partageons des choses au quotidien, cela réaligne les valeurs et les besoins vers l’essentiel. La médication est encore lourde et présente de nombreux effets secondaires alors nous essayons d’implanter un environnement pour le patient (couverture lourde, sas d’isolement, etc.) pour qu’il puisse reprendre le contrôle sur sa maladie, se rétablir et un jour, sortir d’ici. »