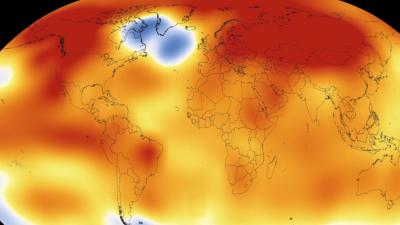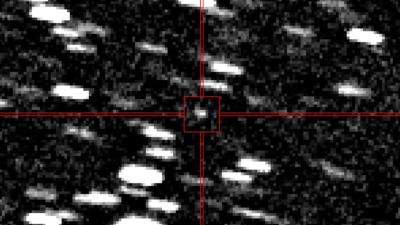Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Brève parenthèse avant l'entrée en matière. Je vis présentement une année sabbatique et je travaille depuis 2 semaines à Paris. Je ne sais pas comment les découvertes à l'origine du prix Nobel de chimie furent décrites au Québec, mais ce fut une horreur en France. Après les « explications » de France Inter, de France Info et de Libération, qui parlait d'un mélange d'équipes de soccer et de rugby, j'étais complètement confus. Il m'a fallu me tourner vers des sources sérieuses afin de comprendre l'importance de la métathèse, dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui n'est pas compliquée que ça, dans ses principes à tous le moins.
Pour des raisons économiques et commerciales, la chimie organique domine la discipline. L'enjeu ici n'est pas vraiment de comprendre, mais plutôt de trouver des recettes afin de préparer de nouvelles molécules organiques aux propriétés technologiques intéressantes ou encore d'inventer des méthodes de production plus efficaces pour la préparation de produits rares à partir de produits communs. Les molécules ainsi assemblées sont appelées produits de synthèse.
Pour transformer les molécules, il faut d'abord les séparer en composantes qui seront alors réassemblées. Dans le cas de molécules organiques, on cherche généralement à briser une des liaisons entre deux atomes de carbone dans cette molécule. On ne peut s'y prendre n'importe comment, toutefois, car si on attaque trop brutalement ou à l'aveuglette, on risque de détruire également les structures chimiques qu'on aimerait transférer des réactants aux produits.
La métathèse est une méthode qui permet justement de briser une double liaison carbone-carbone et de la reformer en présence de molécules catalytiques. (Vous savez certainement qu'un catalyseur favorise une réaction chimique sans toutefois être transformé par celle-ci.) Le mot même, proposé en 1967, est dérivé du grec : meta veut dire changer et thèse, position. La métathèse permet donc de changer la position d'un groupe relié par une double liaison carbone-carbone.
Une première réaction de métathèse catalysée avait été observée dans les années 1950 lors de la polymérisation de l'éthylène. On ignorait toutefois la nature des étapes chimiques intermédiaires menant à ces polymères. Ce n'est qu'en 1971, après une quinzaine d'années d'études par plusieurs groupes, qu'Yves Chauvin et son étudiant Jean-Louis Hérisson annoncèrent leur solution, qui porte maintenant le nom de cycle catalytique de Chauvin. L'étape critique de ce cycle est l'utilisation de métallocarbène comme catalyseur. La double liaison du carbone peut ainsi être transférée vers cette molécule, permettant de stabiliser les états intermédiaires et de diminuer la barrière de réaction. Malheureusement, les métallocarbènes étaient alors des molécules très fragiles qui réagissaient au contact de l'air de l'eau. En 1974, Richard Schrock fut le premier à synthétiser un métallocarbène stable. Malheureusement, cette molécule ne pouvait pas être utilisée dans la métathèse. Mais Schrock n'abandonna pas la partie et son groupe découvrit plusieurs familles de métallocarbènes fort réactifs dans les années 80. Au début des années 1990, Robert Grubbs découvrit une nouvelle famille, appelée métallovinylidène, qui offrait des avantages considérables par rapport aux carbènes.
Grâce à ces catalyseurs, et à d'autres développés depuis, la métathèse occupe une place importante en chimie organique et elle a permis la production de nouveaux polymères synthétiques de même que de molécules actives biologiquement, permettant le développement de nouveaux médicaments.
Au-delà de la découverte, la personnalité des brillants chercheurs récompensés par la Fondation Nobel nous permet de mieux comprendre ce monde souvent bien caché derrière de lourdes portes. Visitant la France au moment où le prix Nobel de chimie fut annoncé, j'ai pu entendre et entrevoir Yves Chauvin, qui fit toute sa carrière dans un laboratoire de recherche appliqué l'Institut français du pétrole, découvrant une personnalité qui aurait certainement beaucoup de difficulté à percer de nos jours. Ainsi, il semble que Chauvin ait l'âme rare du chercheur passionné par la science et non la reconnaissance de ses pairs. Après l'annonce de son prix, il est resté très discret, presque embêté. Il ajouta qu'il était trop vieux, à 75 ans, pour recevoir ce prix. Une telle personnalité aurait bien de la difficulté à survivre aujourd'hui, à l'ère des concours de subvention ultracompétitifs et des listes d'universités qui forment et déforment les carrières. J'y reviendrai certainement. Pour le moment, ajoutons nous félicitations à la liste, déjà bien longue, de ceux qui ont reconnu le caractère exceptionnel des trois récipiendaires du prix Nobel de chimie 2005.