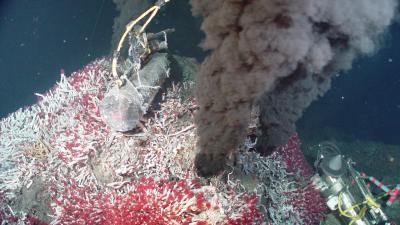Dans les jeux vidéo comme dans la vraie vie, les comportements de coopération s’avèrent gagnants. Face à un prédateur, il pourrait sembler tentant de vouloir sacrifier un ou plusieurs membres de sa tribu pour s’en sortir, alors que de faire face en bloc offrirait plus de chances à chacun.
À lire également
« Comme biologiste, on a changé notre regard, d’une interaction proie-prédateur à une interaction mutualiste-coopération. Les jeux vidéo nous offrent un environnement dans lequel il est possible de tester des hypothèses biologiques et d’évolution », résume le professeur de sciences biologiques de l’UQAM, Pierre-Olivier Montiglio.
Le chercheur et son équipe étudient en effet les comportements sociaux dans l’environnement des jeux multijoueurs – des jeux en ligne où compétitionnent plusieurs joueurs. Leur recherche est parue en mai dans la revue Trends in Ecology & Evolution.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
L’un des jeux utilisés pour cette étude, Dead by Daylight, met en scène un prédateur et quatre potentielles proies. Ce jeu, développé par la compagnie québécoise Behaviour Interactive, montre que les interactions sociales entre prédateurs et proies génèrent souvent des « dynamiques éco-évolutives » complexes avec un ensemble de traits comportementaux que l’on retrouve dans la nature.
Alors que le public associerait plutôt des jeux avec des animaux et leurs avatars à une perspective écologique, tel que Animal Crossing —qui consiste à se créer un environnement de rêve sur une île— le Pr Montiglio pense que ce n’est pas forcément la thématique naturelle qui fait la qualité d’un jeu, du moins pour les chercheurs en biologie.
« Surtout que bon nombre de jeux ne sont pas réalistes. Ce qui est intéressant, c’est la mécanique du jeu et ses règles, les choses que l’on peut faire, ou pas, et les manières de les optimiser. »
Il donne en exemple Eve Online, un jeu en ligne multijoueur se déroulant dans un univers de science-fiction spatiale, doté d’une modélisation réaliste.
Le comportement du joueur façonne la dynamique des populations et des communautés par le biais de rétroactions avec la configuration de l'habitat et les réseaux. « L’algorithme ne va pas reproduire des patrons prévisibles. C’est un jeu qui laisse une grande part à l’aléatoire, ce que l’on retrouve souvent dans la nature », décrit le chercheur.
Multijoueurs, multiples interactions
Les jeux vidéo multijoueurs permettent aux chercheurs de suivre les mouvements, les comportements, les interactions et les performances d'un grand nombre d’êtres humains et d’animaux confrontés à des défis écologiques dans un environnement facile à gérer.
Ces jeux offrent de plus des environnements réalistes, ainsi qu'un volume considérable d’interactions possibles. Car plus il y a de joueurs, plus ça devient complexe.
Comme dans la vraie vie. Il est impossible « de prédire et d’anticiper par les modèles mathématiques » comment interagit un joueur moyen, parce qu’un joueur moyen, ça n’existe pas, note le Pr Montiglio.
Ces jeux pourraient même favoriser les progrès de la recherche sur les comportements et sur les interactions entre l’écologie et l’évolution: les données issues de ces jeux pourraient compléter les études de populations à long terme.
Par exemple, plutôt que de combattre, diverses stratégies sont explorées afin de conserver ou gagner une ressource ou une portion de territoire. « Nous pouvons les intégrer dans les modèles plus réalistes pour comprendre le comportement humain. Et c’est possible de les appliquer aux animaux, de rendre plus prédictive notre hypothèse », assure-t-il.
En plus, il faut reconnaître que les jeux vidéos forment une composante importante de la vie de bien des gens: certains y jouent deux ou fois par semaine. Et donc, cela contribue à mieux comprendre l’être humain.
Des jeux comme Minecraft ou Space Engineers —axés sur la collecte et la transformation de ressources naturelles— « changent notre regard de proie/prédateur à mutualiste/coopération. Cela pourrait même permettre d’améliorer les jeux en les rendant plus réalistes », affirme encore le chercheur
« C’est programme de recherche que je connais et que je trouve valide, original et intéressant », commente le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, Dominique Berteaux.
Il existe certaines règles dans le fonctionnement du vivant qui s’appliquent aussi bien aux humains qu’aux animaux ou aux autres organismes, « si bien que l’étude des interactions dans les jeux vidéos peut être un modèle intéressant pour comprendre le fonctionnement du vivant en général », confirme ce professeur d’écologie.