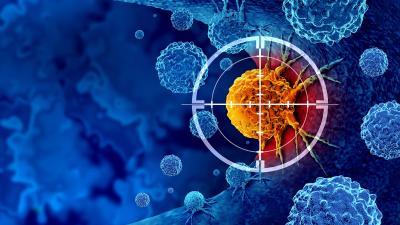À cette question, Jean-Marc Lévy-Leblond répond par la négative. Selon lui, la science moderne est une construction d'abord culturelle qui remonte au XVIIe siècle, à l'époque de Galilée (1564-1642) et de René Descartes (1596-1650), mais aussi de plusieurs autres philosophes scientifiques tels que Francis Bacon (1561-1626) et Christian Huygens (1629-1695), qui jetèrent les bases de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, essentiellement occidentale, européenne et, suite à la colonisation, américaine. Elle puise sa source dans la tradition grecque, disparue en Europe pendant près de mille ans, mais préservée et considérablement étendue dans le monde arabo-musulman au début du second millénaire avant de revenir en Europe à la Renaissance. Ce cheminement n'était pas prédestiné, toutefois, loin de là. Tout comme la race humaine n'est pas l'aboutissement de l'Évolution, mais seulement une étape qui aurait tout aussi bien pu ne pas survenir, la science contemporaine n'est pas essentielle au développement et à la survie des civilisations; l'Inde et la Chine ont survécu et prospéré sans une science indépendante, ciblant une compréhension rationnelle de notre environnement. La science pratiquée aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec l'étude de la nature telle qu'elle fut menée dans les autres civilisations.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Je partage ici l'opinion de Lévy-Leblond: la pratique de la science est avant tout culturelle. Au point qu'elle peut être complètement absente ou suivre un schéma qui n'a rien à voir avec l'entreprise actuelle. Je diffère toutefois de la position du physicien-philosophe en ce qui concerne la pertinence et la permanence des résultats de la science moderne. En effet, Lévy-Leblond est prêt à jeter le bébé avec l'eau du bain : sans l'écrire directement, il laisse entendre que si la pratique de la science est culturelle, alors les résultats le sont aussi.
Or, il est essentiel de séparer la pratique de la science, ses résultats et son interprétation. Si la pratique et l'interprétation sont avant tout culturelles, les résultats existent dans l'absolu. Qu'on le veuille ou non, la base du code génétique est emmagasinée sous la forme d'une double hélice d'acide désoxyribonucléique. Que l'on soit créationniste ou shintoïste, le fait demeure. Son interprétation peut varier, évidemment, de même que l'importance de ce savoir dans la société. Il peut être ignoré, placé dans un contexte religieux ou utilisé pour des développements technologiques. Ces applications, bien qu'associées à la science, sont avant tout culturelles et ne remettent pas en question la vérité scientifique absolue du fait, caché derrière les voiles de l'interprétation.
Cet exemple montre donc qu'il est essentiel de séparer les diverses facettes de ce qu'on appelle « science » : historique, philosophique, culturelle et « fondamentale ». Contrairement à Lévy-Leblond, il me semble que ce dernier aspect est absolument universel. Les lois de gravitation de Newton s'appliquent à tout l'Univers. Qu'on soit catholique, musulman, juif, sikh ou laïc, on tombe de la même façon. La recherche d'une explication peut n'avoir aucun intérêt, la signification profonde de cette chute peu variée, mais sa réalité demeure.
Comme toutes les activités humaines, la science est une entreprise complexe qui mélange allègrement les côtés universels et culturels. Les scientifiques ont tendance à donner une importance peut-être démesurée à l'aspect universel. Dans la foulée du post-modernisme, les philosophes, même scientifiques, tels que Lévy-Leblond, ont tendance à faire le contraire : toute réalité, pour eux, est d'abord une affaire d'interprétation. Pourtant, peu importe l'interprétation, les faits demeurent : qu'on croit ou non à la mécanique quantique, une bombe nucléaire qui explose libère la même énergie dévastatrice, et des ossements de dinosaure continueront à être trouvés qu'on accepte ou non la théorie de l'évolution.
Cette réalité n'implique pas que certaines civilisations soient meilleures que d'autres ou qu'une approche scientifique soit préférable à une autre; tout dépend des critères qu'on établit. C'est ici aussi qu'erre Lévy-Leblond. Sous prétexte d'éviter de placer la civilisation occidentale contemporaine en haut de la pyramide, il rejette même l'idée d'une science décrivant une réalité extérieure à l'humain.
Heureusement, la réalité finit toujours par rattraper la fiction...