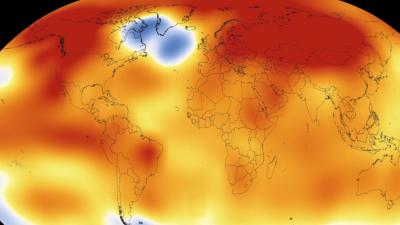Le vétérinaire repère rapidement la nature du problème: un morceau de terre bloque la gorge de l’animal, d’où l’obstruction des voies respiratoires. L’histoire aurait pu se terminer ainsi, si le vétérinaire n’avait pas remarqué des moisissures à l’aspect curieux attachées au morceau de terre. Connaissant la passion du professeur Selman Waksman, un microbiologiste de renom de l’Université Rutgers, pour les moisissures du sol, il lui fit parvenir l’échantillon.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Selman Waksman, un juif d’Ukraine, émigra aux États-Unis en 1910 et, huit ans plus tard, obtenait un doctorat en biochimie de l’Université de Californie à Berkeley. Dans son pays d’origine, il avait été frappé par l’odeur que dégageaient les riches sols agricoles. Il comprit plus tard que cette odeur émanait de moisissures appelées actinomycètes; une découverte qui l’amena à étudier le rôle des microorganismes dans la fertilité des sols. Plus tôt dans sa carrière, le professeur Waksman avait remarqué que la bactérie responsable de la tuberculose était rapidement détruite en présence de terre. Il ne s’était pas attardé longuement à cette observation, jusqu’à ce que la découverte de la pénicilline démontre qu’il était possible que des moisissures possèdent des propriétés antibactériennes. Après avoir évalué plus de mille cultures issues de différentes familles d’actinomycètes, le chercheur isola deux antibiotiques, soit l’actinomycine et la streptothricine. Malheureusement, la toxicité de ces deux composés était trop élevée pour qu’ils puissent être administrés à l’humain. Mais Selman Waksman savait néanmoins qu’il était sur la bonne voie. Lorsque l’échantillon envoyé par son collègue vétérinaire arriva dans son laboratoire, il le confia à Albert Schatz, un de ses jeunes doctorants.
Ce dernier identifia le microorganisme comme appartenant à la famille des actinomycètes, et lui donna le nom de Streptomyces griseus. Cette appellation fait référence à la présence de moisissure, strepto, qui signifie chaîne en grec (voir photo ci-dessus), à la famille myces (moisissure) et à la couleur (grisâtre). Après avoir soumis l’échantillon à une batterie de tests, Albert Schatz démontra que ce microorganisme était doté de propriétés antibiotiques puissantes et qu’il était particulièrement efficace contre des bactéries résistantes à la pénicilline, dont celle responsable de la peste bubonique, de la dysenterie et de la fièvre typhoïde. Ces résultats amenèrent le jeune chercheur à tester le Streptomyces griseus sur le bacille de la tuberculose, incurable à l’époque. Les résultats furent spectaculaires: le bacille de la tuberculose ne pouvait survivre en présence de Streptomyces griseus.
Le plus difficile restait à faire. Il fallait isoler la molécule produite par le microorganisme, responsable de l’activité antibactérienne. Le doctorant travailla sans relâche, passant tout son temps au laboratoire. Il y aménagea même un lit de fortune afin de pouvoir surveiller ses expériences jour et nuit. Finalement, il obtint une quantité suffisante d’antibiotique —auquel il donna le nom de streptomycine— pour effectuer des essais cliniques. Ces essais, conduits entre 1946-1947 par un consortium de laboratoires pharmaceutiques, ont été réalisés auprès de milliers de sujets. Pour l’histoire ceci représentait la toute première étude aléatoire à double insu comparative avec placebo, visant à mesurer l’efficacité d’un médicament. L’indication recherchée fut confirmée, et la streptomycine fut mise sur le marché dès la fin de 1947, sauvant ainsi d’une mort certaine des millions de personnes dans le monde.
Selman Waksman fut alors qualifié de héros et partagea avec l’Université Rutgers des milliers de dollars en redevances issues de la vente de la streptomycine. Bien que le nom d’Albert Schatz apparaissait en premier sur les publications scientifiques annonçant la découverte du médicament, ainsi qu’aux côtés de celui de Selman Waksman dans la demande de brevet déposée par l’Université Rutgers, sa contribution passa complètement sous silence. Selman Waksman et l’Université Rutgers considéraient l’apport d’Albert Schatz comme celui d’un assistant qui avait eu la chance de se trouver au bon endroit, au bon moment.
Révolté par cette injustice, le doctorant entreprit des démarches qui choquèrent le milieu scientifique. Il entama une poursuite judiciaire contre Selman Waksman, son directeur de recherche, et contre l’Université Rutgers. Embarrassés par le scandale, les accusés décidèrent de régler le litige hors cours, et Albert Schatz fut reconnu comme codécouvreur de la streptomycine et reçu la part des redevances qui lui revenaient.
Si son avenir financier était assuré, Albert Schatz paya néanmoins le prix fort pour les conséquences de son geste. En dépit de son talent, il eut de la difficulté à trouver un emploi, les laboratoires enclins à embaucher un candidat qui avait eu l’audace de poursuivre son directeur de recherche se faisant rares. En 1952, deux ans après le règlement, Selman Waksman reçut, seul, le prix Nobel de médecine pour «la découverte de la streptomycine, le premier antibiotique efficace contre la tuberculose». Burton Feldman, historien des prix Nobel, écrivit par la suite que Selman Waksman avait été nobélisé «pour ne pas avoir découvert la streptomycine». Et c’est ainsi que se termine une longue histoire, qui a commencé par un morceau de terre logé dans la gorge d’une poule.