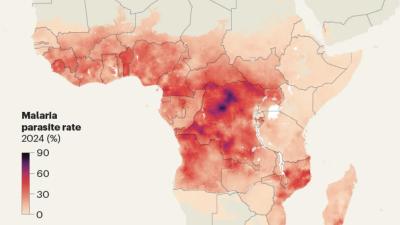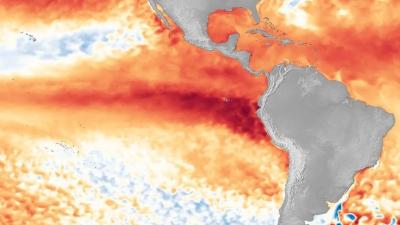Cet article est tiré du Dossier Culture scientifique, produit par Découvrir #MagAcfas. Les 12 textes en provenance de 10 pays ont été rassemblés par deux spécialistes du domaine, Joëlle Le Marec (Paris-Sorbonne) et Bernard Schiele (UQAM). Ce tour d’horizon accompagne les Journées internationales de la culture scientifique – Science & You, tenues à Montréal, les 4, 5 et 6 mai 2017.
Dans les lignes qui suivent, je me contenterai d’en donner une illustration pointant deux moments particuliers d’une histoire longue de la culture scientifique et technique en France, remontant donc à des moments où cette dénomination n’avait pas encore cours. Tout au long de cette histoire, l’engagement de la puissance publique – tout d’abord nationale et, de plus en plus, régionale ou européenne dans la promotion et le développement de la culture scientifique et technique apparaît comme un facteur déterminant.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
On en trouve de premiers signes dès l’après-Seconde Guerre mondiale. À la fin des années 19501, au fur et à mesure que se construit un système de recherche en France, des voix s’élèvent, au plus près de l’administration de la recherche naissante et de ses responsables politiques, pour insister sur le besoin de développer ce que l’on n’appelle pas encore – il s’en faut de 20 à 30 ans – la culture scientifique. En premier lieu, il s’agit de reconstruire le pays. Une reconstruction certes matérielle (restaurer des infrastructures et une industrie), mais également symbolique, puisqu’il s’agit de rétablir la France dans son rang. Pour cela, de nombreux scientifiques, politiques, éducateurs s’accordent sur un point : il faut former davantage de techniciens, d’ingénieurs, de scientifiques.
Il faut les repérer et les convaincre. On identifie des bassins inexploités : les catégories populaires et les femmes. Les moyens de les atteindre sont tout trouvés : les techniques nouvelles, c’est-à-dire films, disques, radio et télévision. Il s’agit de toucher les jeunes générations, et notamment les jeunes filles, afin de les motiver à entamer des carrières scientifiques, mais encore, ces moyens constituent, souligne-t-on, des outils de choix pour la formation permanente : celle des ouvriers pour qu’ils deviennent techniciens, des techniciens pour qu’ils deviennent ingénieurs. On remarque ici deux choses. Premièrement, que l’accent mis sur l’importance de susciter des vocations (de techniciens, d’ingénieurs et de scientifiques, pour l’industrie et pour la grandeur de la nation), et même l’appel tout particulier aux filles, est loin d’être un phénomène nouveau. Deuxièmement, que, comme aujourd’hui avec les technologies numériques, ceux qui souhaitent rendre la science publique ont une indéniable propension à s’emparer des nouveaux outils à leur disposition et à revendiquer le recours à ces technologies nouvelles. Des moyens modernes pour un objet toujours moderne, en quelque sorte – ou l’innovation technologique pour acculturer l’innovation technoscientifique.
La mobilisation politique et scientifique sur ces questions durera un certain temps, celui qu’il faut pour que naissent les structures nécessaires. Puis cet intérêt disparaîtra chez la puissance publique, centrée sur d’autres priorités.
La décennie suivante verra l’émergence, dans les institutions nées de la décentralisation culturelle (maisons de la culture, MJC…), d’un nouveau type d’activité : l’action culturelle scientifique. Conformément au projet d’André Malraux, les maisons de la culture s’étaient en effet ouvertes sur des projets polyvalents qui, le plus souvent, prenaient en compte la thématique scientifique : ce fut le cas au Havre, à Bourges, Reims, Nanterre, Chalon-sur-Saône, Saint-Étienne, etc., et notamment à Grenoble, ville qui vit la naissance du premier CCSTI (centre de culture scientifique, technique et industrielle) en 1979. La présence dans les maisons de la culture de ce qui était ici simplement considéré comme un « autre aspect de la vie culturelle » répondait à la fois au souhait des acteurs scientifiques, soucieux de ne pas être coupés de la population, et à celui de l’administration de la culture, qui mettait en œuvre une doctrine faisant fond sur une conception universaliste de la culture2. Ces activités ne seront pas, loin s’en faut, marginales. Non seulement elles drainent un public important (300 000 entrées en cinq ans à Grenoble), mais encore, elles donnent lieu à un réseau organisé : le Groupe de liaison pour l’action culturelle scientifique (Glacs), créé à la suite du colloque La place des sciences dans l’action culturelle organisé en 1974 à la maison de la culture de Grenoble. Le Glacs sera à l’origine de la série phare d’activités de vulgarisation de cette période, celle des Sciences (physique, astronomie, limnologie…) dans la ville, dont la première édition, sous le nom d’Aix-Pop, avait eu lieu à l’occasion d’un congrès de physique à Aix-en-Provence en 1973.
Au regard de cette présence – dès l’origine et à la satisfaction de tous – de l’activité scientifique dans les institutions culturelles, on peut se demander pourquoi l’idée d’une regrettable absence de la prise en compte des sciences dans la « culture » a été si prégnante. L’histoire du CCSTI de Grenoble nous apprend au contraire que plus qu’une absence de prise en compte de la thématique scientifique dans les institutions culturelles, c’est de la revendication de la spécificité de celle-ci que les CCSTI sont la trace.
La suite de l’histoire, au début des années 1980, est connue. Les engagements multiformes des années 1970 (citons les boutiques de sciences, la critique des sciences, le développement de contre-expertises scientifiques au service des mobilisations contestataires et, bien sûr, l’action culturelle scientifique3) forment le terreau sur lequel le mouvement de culture scientifique va se construire. Le regain d’intérêt de l’administration, enjointe de mettre en œuvre la volonté du ministre4, rendra possible l’émergence du mouvement sous une dénomination encore instable, puis son institutionnalisation. Au fil de ces presque quatre décennies, le mouvement de la culture scientifique en France s’est adapté à de multiples changements affectant aussi bien ses outils que les objectifs qui lui étaient assignés, les tutelles qui les lui assignaient et la société dans laquelle il s’inscrivait. Le « tournant participatif » est l’un de ceux-là. Signe-t-il la fin du mouvement de la culture scientifique ou en est-il l’une des nombreuses transformations? La question me semble mériter plus ample examen.
- Andrée Bergeron, Centre Alexandre Koyré d'histoire des sciences et des techniques, France
L'auteure est maître de conférences des universités en épistémologie et histoire des sciences et des techniques à Universcience, membre de l’IFRIS et chercheuse au Centre Alexandre Koyré d'histoire des sciences et des techniques (EHESS-CNRS-MNHN, PSL* Research University). Outre l’histoire des politiques culturelles des sciences en France au 20e siècle, ses recherches ont porté sur diverses formes de la vulgarisation (dans la littérature, dans la télévision publique des années 60, dans le cinéma documentaire, dans les musées scientifiques de l’entre-deux-guerres). Elle a récemment coordonné, avec Charlotte Bigg (CNRS, Paris) et Jochen Henning (Université Humboldt, Berlin), le programme de recherche international Matières à penser : les mises en scène des sciences et leurs enjeux (19e-21e siècles).