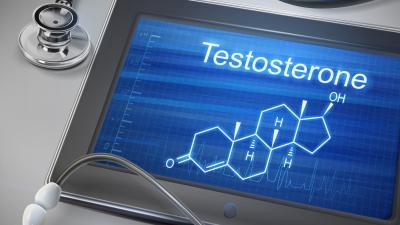En cette ère où les politiciens d’extrême-droite ont la cote dans certains pays, des universitaires ont choisi de publier, à l’intention de leurs collègues, un « guide de survie » face aux autocrates, c’est-à-dire ces politiciens qui tendent à entraîner leur pays sur une pente glissante vers un régime de plus en plus autoritaire.
À lire également
Intitulé The Anti-Autocracy Handbook, le document se veut un « appel à l’action, à la résilience et à la défense collective de la démocratie, de la vérité et de la liberté académique ». La vingtaine de signataires provient notamment des sciences politiques, de la recherche médicale et de la psychologie.
Entre la Russie de Poutine, la Hongrie d’Orban et les États-Unis de Trump, les définitions de la frontière entre une démocratie et une autocratie varient, mais les auteurs proposent, pour repérer les signaux d’alarme, la combinaison « des 3 P: populisme, polarisation et post-vérité ».
Leurs chefs se présentent comme les voix du « peuple » contre les « élites corrompues », exacerbent les divisions sociétales et s’attaquent aux faits dans le but de s’éviter de devoir rendre des comptes.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Il en résulte des attaques contre les médias, les tribunaux et les universités. Dans le cas des universités, d’un pays à l’autre, ces attaques ont pris la forme de coupes budgétaires dans les sujets qu’un gouvernement juge « sensibles », de limitations aux collaborations internationales et de censure —sous le prétexte officiel de lutter contre la censure.
Et ce guide est paru avant que le président Trump ne congédie la commissaire du Bureau des statistiques du travail, Erika McEntarfer, parce qu’il n’aimait pas les derniers chiffres.
Si le document s’adresse aux universitaires, c’est parce qu’ils font partie des groupes professionnels qui ont le plus grand pouvoir de résistance, écrivent les auteurs. Certains sont certes plus à risque que d’autres —les jeunes chercheurs en particulier, ceux qui n’ont pas de protection d’emploi— mais même ceux dont la carrière est bien assurée ignorent souvent les outils qui sont à leur disposition: des outils numériques pour protéger leurs données menacées de disparition, ou pour raconter ce qui leur arrive.
« Si vous vous retrouvez dans une position relativement sécuritaire », lit-on, « votre rôle est d’utiliser ce pouvoir pour défendre les autres et protéger la communauté scientifique. Ça implique davantage que de juste en parler: c’est s’engager publiquement avec les gens autour de vous » par exemple en dénonçant les désinformateurs et en nommant les faits, à travers les réseaux sociaux, dans les événements scientifiques ou dans les médias locaux.
Certains chercheurs sont plus à risque que d’autres, mais certaines disciplines sont également plus à risque d’être attaquées, note un billet de l’Union européenne des géosciences:
Des changements climatiques jusqu’à la justice environnementale, plusieurs de nos disciplines sont directement affectées par les narratifs politiques et la désinformation. Il ne s’agit pas seulement de nous protéger nous-mêmes: il s’agit de protéger les conditions qui rendent la science possible.
Lorsque les tendances autoritaires se lèvent, poursuit l’auteur du billet, « les faits deviennent une nuisance ».
De fait, le 23 juillet, dans un rapport du ministère américain de l’Énergie destiné à justifier l'annulation de politiques environnementales, on trouvait au moins 100 déclarations fausses ou trompeuses, selon une compilation du magazine Carbon Brief.
De la même façon, le 22 mai dernier, le rapport de la commission dirigée par Robert F. Kennedy Jr, destiné à orienter les politiques de santé sur les enfants, citait des études qui n’existent pas et attribuait à des scientifiques des conclusions qui n’étaient pas les leurs.
Les auteurs du guide, sous la direction du psychologue et expert en désinformation Stephan Lewandowsky, de l’Université de Bristol, en Grande-Bretagne, rappellent que depuis 2003, la proportion de la population mondiale qui vit sous des régimes autoritaires, plutôt que démocratiques, a augmenté et que certains des organismes qui analysent cette évolution ont récemment rangé les États-Unis parmi les pays « à surveiller ».