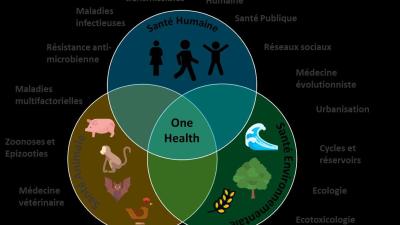En effet, non seulement marcher dans les traces d’un autre peut être jugé moins intéressant pour un chercheur, mais arriver en plus à un résultat négatif — par exemple, « cette molécule n’a aucun impact » — enlève parfois jusqu’à l’envie de publier ces « non-résultats ». C’est pour cette raison que le Collège européen de neuropsychopharmacologie vient de lancer un prix doté d’une récompense de 10 000 euros, pour l’article qui présentera les meilleurs « résultats négatifs en neurosciences précliniques ». Le Collège suit les traces de l’Organisation pour la cartographie du cerveau humain, qui a créé l’an dernier un prix de 2000 $ pour « la meilleure étude de réplication » — que celle-ci ait confirmé ou non les résultats initiaux. L’espoir est que ces initiatives encouragent les organismes subventionnaires à reconnaître eux aussi l’importance de financer davantage d’études « de réplication ».
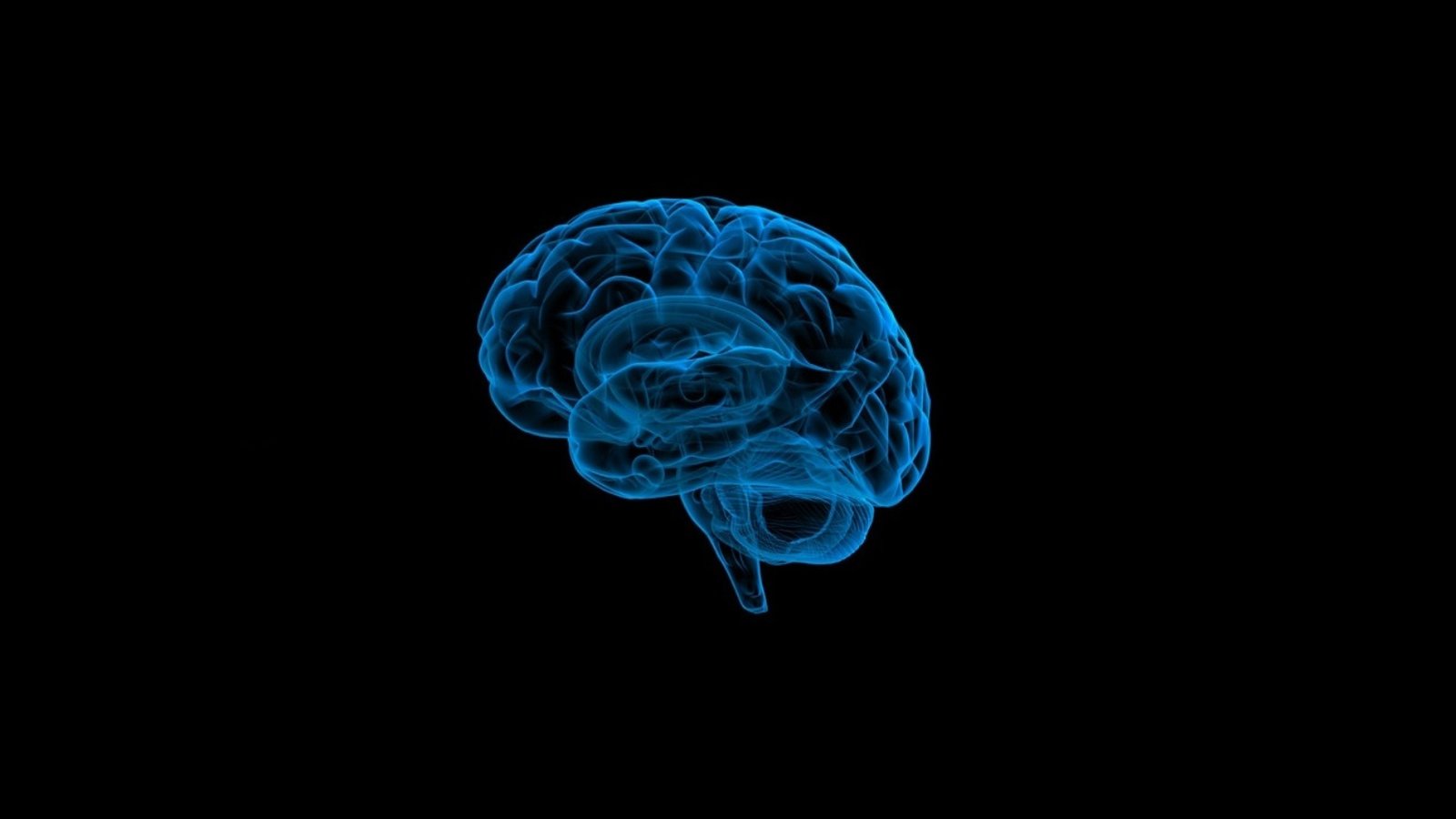
Pour un chercheur, faire une expérience qui se contente de refaire l’expérience d’un autre, ce n’est pas très stimulant, mais c’est pourtant indispensable pour démontrer si l’autre avait raison, ou s’il avait tort. Or, pour montrer à quel point la chose devrait être encouragée, deux prix viennent d’être créés, qui récompensent de tels efforts — y compris s’ils arrivent à un résultat négatif.
Les plus populaires
Vérification éclair : un remède contre le cancer du pancréas ? Pas tout à fait
Lundi 16 février 2026
La nouvelle salve contre les vaccins à ARN
Vendredi 13 février 2026
Les Jeux d’hiver 2026 seront-ils carboneutres?
Mercredi 18 février 2026