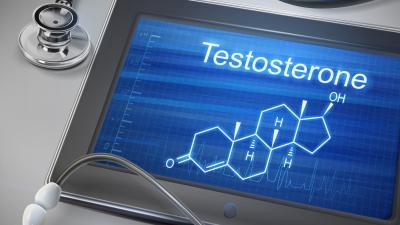Plusieurs publications récentes sur les réseaux sociaux laissent entendre que les vaccins provoqueraient le décès des jeunes enfants —et qu’on le cacherait. Le Détecteur de rumeurs a voulu savoir si la littérature scientifique s’était penchée sur cette question.
Cet article fait partie de la rubrique du Détecteur de rumeurs, cliquez ici pour accéder aux autres textes.
À lire également
Faits à retenir
- La rumeur naît de décès survenant peu de temps après la vaccination
- Comme ce syndrome frappe des bébés, il est inévitable qu’un certain nombre de décès se produisent dans la période suivant un vaccin.
- Des études ont suggéré que le vaccin pourrait avoir un effet protecteur
Les origines de la rumeur
Le syndrome de la mort subite du nourrisson correspond au décès soudain et inattendu d’un bébé en apparence en santé avant l’âge d’un an, rappelle l’Académie américaine de pédiatrie dans un texte de vérification de faits visant précisément à réagir à cette rumeur. Selon les scientifiques, ce syndrome pourrait être causé, par exemple, par une anomalie du tronc cérébral qui empêche l’enfant de se réveiller.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Ce n’est pourtant pas d’hier que circule l’idée selon laquelle les vaccins seraient les vrais responsables. Déjà en 2001, des chercheurs du Royaume-Uni écrivaient que dans les 20 années précédentes, plusieurs rapports anecdotiques avaient fait état d’une association possible entre les vaccins et la mort subite du nourrisson.
En 2025, la rumeur se propage toujours, en particulier sur les réseaux sociaux. Par exemple, on peut trouver plusieurs publications récentes sur Instagram qui allèguent que « les vaccins tuent ».

Pas de tendance préoccupante
Les partisans de cette hypothèse avancent qu’il existerait un lien de cause à effet parce que, selon eux, les cas de mort subite du nourrisson surviendraient généralement dans les jours qui suivent la vaccination. Pour affirmer cela, ils s’appuient sur la plateforme américaine VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System, ou Système de notification des effets indésirables des vaccins).

Cette plateforme permet à n’importe qui — patient, membre de la famille ou professionnel de la santé— de publier ce qu'il présume être un effet secondaire d'un vaccin. Non seulement la plateforme est-elle ouverte à tout le monde, mais de plus, il n’est pas nécessaire de démontrer que le vaccin a causé l’effet rapporté : des experts se chargeront de vérifier ce qu’il en est. Pour cette raison, ceux qui gèrent VAERS prennent bien soin de souligner qu’un témoignage sur VAERS ne peut pas être considéré comme une preuve de quoi que ce soit.
En 2015, des chercheurs des Centres de contrôle des maladies (CDC) des États-Unis, ont analysé les décès rapportés dans VAERS entre 1997 et 2013. Parmi les 1244 décès chez les enfants pour lesquels le registre fournissait un rapport médical ou un rapport d’autopsie, un peu moins de la moitié (44%) avaient été attribués au syndrome de la mort subite du nourrisson. Parmi les autres causes de décès les plus courantes, il y avait l’asphyxie, des infections du sang et des pneumonies.
Soit ce qu’on observe dans la population américaine en général, vaccinée ou non, avaient conclu les chercheurs. Autrement dit, ces données ne montraient aucune tendance préoccupante
Attention aux associations temporelles
Le facteur temps est évidemment une préoccupation dès qu’on parle de risques présumés du vaccin. Selon les observations des chercheurs des CDC, chez les moins de 1 an, la moitié des décès rapportés sur VAERS avait eu lieu dans les 2 jours suivant la vaccination. En 2025, dans son texte de vérification de faits, l’Académie américaine de pédiatrie rappelait toutefois que ce n’est pas parce que deux phénomènes se produisent en même temps qu’ils sont reliés.
Le simple hasard peut en effet expliquer que certains enfants victimes de la mort subite du nourrisson aient été vaccinés récemment, soulignaient en 2006 des chercheurs australiens. Considérant l’âge moyen des décès causés par ce syndrome, ces chercheurs avaient calculé la probabilité qu’un enfant ait été vacciné dans les 24 à 48 heures précédentes. En tenant compte du pourcentage d’enfants vaccinés à différents âges, ils ont estimé que cette probabilité était de 1,3 % et 2,6 % respectivement : cette coïncidence malheureuse se produirait donc environ une fois par année en Australie, concluaient-ils.
Un effet protecteur
Des recherches sont même allées plus loin. Par exemple, en 2001, des chercheurs ont comparé le taux de mort subite du nourrisson avant et après la modification du calendrier de vaccination au Royaume-Uni: celui-ci avait eu pour effet d’accélérer l’immunisation des tout-petits. Ces chercheurs ont remarqué qu’il y avait moins d’enfants vaccinés parmi les bébés victimes de mort subite du nourrisson. L’immunisation n’augmentait donc pas le risque de mort subite: elle pourrait même avoir un effet protecteur.
En 2007, des chercheurs allemands ont publié une méta-analyse des résultats de neuf études: leurs résultats ont également suggéré un effet protecteur. Selon leur estimation, la vaccination diminuerait de moitié le risque de mort subite du nourrisson. Cette estimation doit toutefois être interprétée avec prudence étant donné la grande hétérogénéité des études.
Plus récemment, en 2024, sur le site des CDC, on pouvait lire que depuis le début de la campagne « Dos sur le dos » en 1994, les cas de mort subite ont d’abord chuté radicalement, pour se stabiliser dans les années 2000. Pourtant, pendant cette période, le nombre de vaccins administrés aux enfants a augmenté.
Aujourd’hui, plusieurs associations professionnelles (Académie américaine de pédiatrie, Société canadienne de pédiatrie) ainsi que des sources gouvernementales (Santé Canada) soulignent que les vaccins pourraient peut-être avoir un effet protecteur contre la mort subite du nourrisson.
Verdict
Plusieurs études ont démontré qu’il n’y a pas de lien entre les vaccins et la mort subite du nourrisson. Le fait que ces deux événements semblent parfois se produire dans un court intervalle de temps s’appelle une corrélation, et non une relation de cause à effet. Plusieurs études ont en fait suggéré depuis 20 ans que le vaccin pourrait même avoir un effet protecteur.