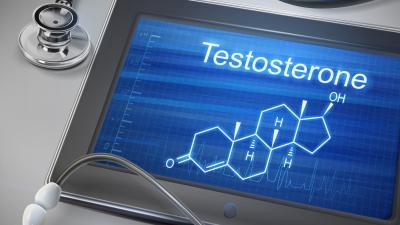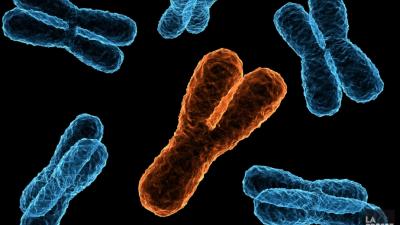Le rat-taupe nu a une espérance de vie de 37 ans, soit beaucoup plus que tous ses cousins rongeurs. Son secret pourrait-il nous servir?
À lire également
Une recherche publiée le 9 octobre dans la revue Science par une équipe chinoise, à l’Université de Shanghai, identifie une mutation, mais pas n’importe quelle mutation: un variant d’une protéine du système immunitaire qui renforce les mécanismes de réparation de l’ADN.
En d’autres termes, la longévité de cet animal serait liée au fait que les dommages à son ADN sont plus souvent réparés. Cela renforce une théorie voulant que, à l'inverse, le vieillissement serait avant tout une affaire de dommages à l’ADN qui sont moins souvent réparés.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
C’est la raison pour laquelle ce type de recherche attire l’attention de tous les spécialistes du vieillissement chez les humains — même s’ils conviennent qu’il y a souvent loin du rongeur à l’humain.
Le rat-taupe nu (Heterocephalus glaber) est un petit rongeur —de 8 à 33 cm de long et généralement de 30 à 35 grammes— essentiellement présent en Afrique de l’Est. Il a pour caractéristique, outre son espérance de vie, sa résistance à certains types de cancers. Son métabolisme présente une capacité limitée de régulation de la température, ce qui en fait pratiquement un mammifère à sang froid.
La protéine identifiée par les chercheurs chinois, appelée cGAS, est en soi une énigme: autant chez la souris que chez l’humain, lorsqu’elle est présente dans le noyau des cellules, elle a cette étrange conséquence de bloquer les réparations à l’ADN, ce qui augmente le taux de mutations et les risques de cancers. Du point de vue de la biologie de l’évolution, on ne comprend donc pas le pourquoi de cette fonction: il pourrait s’agir d’un effet secondaire imprévu de quelque chose d’autre.
Mais chez le rat-taupe nu, sa présence dans le noyau de la cellule a l’effet opposé, soit de renforcer la capacité de l’ADN de se réparer. Et la différence, lit-on dans l’étude, résiderait dans quatre des acides aminés qui composent la protéine cGAS: si elles sont altérées chez le rat-taupe nu, la protéine ne contribue plus aux réparations de l’ADN.
La solution pour les humains serait-elle donc de produire davantage d’une protéine cGAS dont la composition imiterait celle du rat-taupe nu? Ce serait en théorie possible par la manipulation génétique, mais encore faudrait-il, préviennent les chercheurs, s’assurer que cette protéine « améliorée » serait reproduite en nombre suffisamment élevé dans notre corps, ce qui est loin d'être acquis.