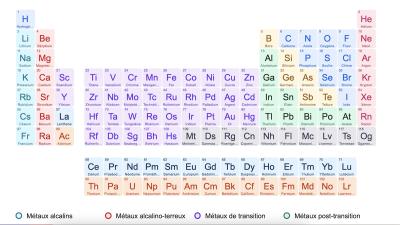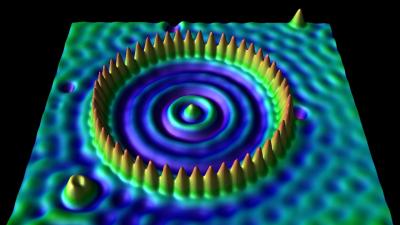Le concept est reflété dans plusieurs cultures. Si jamais cela vous arrive à Budapest, sachez que l'expression est "kutyaharapást szörével". Curieusement, à ma connaissance, il n'y pas d'équivalent en français. L'origine de la phrase est associée à la pratique ancienne de traiter la morsure d'un chien enragé en plaçant un poil de l'animal sur la plaie. Il s’agit évidemment d’un traitement inefficace mais qui s’inscrit dans l'esprit de la théorie des anciens selon laquelle il faut traiter le mal par le mal; en latin, similia similbus curantur.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Curieusement, il y a une petite part de vérité dans cette idée et elle provient du processus de métabolisme de l'alcool. Une fois que l'éthanol, le composé actif dans les boissons alcoolisées, a rempli ses fonctions de "relaxation" il se transforme en acétaldéhyde, puis en acide acétique. Si la consommation d'alcool est trop rapide, notre corps est incapable de suivre et il en résulte une accumulation d'acétaldéhyde dans le sang. Cette accumulation est responsable des symptômes de nausée et vomissements qui suivent immédiatement une forte consommation d'alcool. Par contre, la gueule de bois du lendemain est associée au métabolisme du méthanol, aussi présent dans les boissons alcoolisées. Le méthanol est converti en formaldéhyde, qui entraîne des symptômes similaires à ceux causés par l'acétaldéhyde et auxquels s’ajoute un mal de tête carabiné. L'éthanol et le méthanol sont tous deux désintégrés par la même enzyme, l'alcool déshydogénase.* Toutefois, cette enzyme agit d'abord sur l'éthanol avant de s'attaquer au méthanol. Donc, en théorie, lorsque l’on consomme de nouveau de l’alcool, l'enzyme est sollicitée pour transformer ce nouvel apport d’éthanol, ce qui limite la production de formaldéhyde. Or, bien que cette approche soit appuyée par la chimie de l’alcool, elle ne fait que retarder l’inévitable puisqu’elle n’offre qu'un répit momentané. Une fois que l'enzyme a agi sur l'éthanol, elle revient en force et a encore plus de « matière première » pour produire du formaldéhyde. Il est possible de minimiser les lendemains douloureux en choisissant judicieusement sa boisson. Plus un alcool est vieilli et coloré, plus sa teneur en méthanol est élevée. Par exemple, la vodka contient très peu de méthanol et est moins apte, en quantités comparables avec d’autres boissons, à donner une gueule de bois. Par contre, le whisky ou le cognac représentent les pires choix (bien sûr seulement s’ils sont consommés en quantités excessives). Et pendant le temps des fêtes, rappelez-vous du slogan d'Éduc'alcool : la modération a bien meilleur goût!
*Les femmes sont plus sensibles que les hommes aux effets de l’alcool. Ceci est causé notamment par leur masse corporelle, généralement plus faible que celle des hommes, mais surtout, par le fait que leurs niveaux d'alcool déshydrogénase sont sensiblement moins élevés que ceux des hommes. Le même phénomène fait en sorte que les Asiatiques sont aussi généralement plus sensibles aux effets de l'alcool.
_______________________________________________________________________________________________________ LES MANCHETTES SCIENTIFIQUES d’Ariel Fenster L’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill présente des capsules sur des sujets défrayant l’actualité scientifique. Plus de renseignements sur ces sujets, ou d’autres d’intérêt général, sont disponibles en communiquant avec Ariel Fenster.
Professeur Ariel Fenster Organisation pour la science et la société de l’Université McGill 514 398-2618