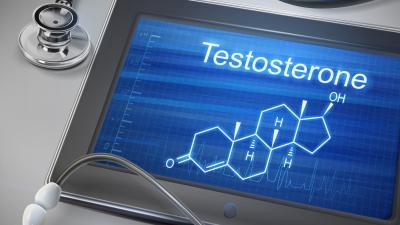Une théorie du complot ne naît pas simplement d’une perception négative des « élites » qui tireraient les ficelles dans l’ombre. Encore faut-il, pour ceux et celles qui y croient, un sentiment d’être traités injustement et une tendance à se voir en victimes de la société.
À lire également
Au point où le degré de sensibilité à l’injustice serait le facteur prédominant pour prédire si quelqu’un est à risque d’adhérer à une théorie du complot. Davantage que l’affiliation politique où le degré de méfiance à l’égard des institutions, selon une étude internationale récemment parue dans l’European Journal of Social Psychology.
Ça ne devrait pas étonner, soulignent les chercheurs. À la base, une théorie du complot est un récit qui génère de fortes émotions: des émotions liées à un sentiment de trahison, de douleur et de victimisation.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
L’hypothèse qu’ils ont donc tenté de vérifier était que de croire en une théorie du complot ne serait pas tant une affaire de méfiance qu’une tentative personnelle « de donner du sens au sentiment d’être injustement traité ». Un sentiment appelé en psychologie le Victim Justice Sensitivity.
Ces personnes, explique l’un des 60 co-auteurs dans la revue de vulgarisation Psychology Today, « sont hypervigilantes » à tout signal qui pourrait vouloir dire qu’on les a trompées et « tendent à voir les autres personnes comme suspectes. Lorsque le monde qui les entoure semble injuste, des récits complotistes offrent une explication ».
À partir d’un questionnaire d’abord testé en Allemagne puis auprès de 15 000 personnes dans 15 pays, ces chercheurs en concluent que ce sentiment, ou ce trait de caractère, ressort du lot dans tous les pays comme le principal prédicteur de l’adhésion à ces théories. Et ce, qu’il s’agisse de théories « généralistes » (comme l’idée que des « événements majeurs » sont cachés au public) ou « spécifiques » (comme le déni des changements climatiques ou la croyance en des vaccins mortels), bien que le sentiment de victimisation soit plus fort avec les complots « généralistes ».
Le fait que l’on observe cette situation dans les 15 pays démontrerait de plus qu’il ne s’agit pas d’un trait spécifique à seulement quelques cultures nationales.
Les observations de ces chercheurs rejoignent les recherches des années 2010 qui avaient établi qu’une personne qui croit à une théorie du complot a de bonnes chances de croire à une deuxième, voire à une troisième théorie. Cela rappelle aussi qu’une façon d’établir un dialogue avec un complotiste ne passe pas seulement par une dénonciation des faussetés, mais par un effort pour comprendre les racines émotionnelles ou psychologiques qui, pour cette personne, ont rendu ce complot attirant.