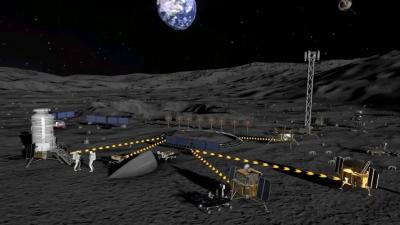En captivité, ils ont un talent indéniable pour imiter la voix humaine et toutes sortes de sons. Et dans la nature? Tout d’abord... ils s’imitent les uns les autres. Mais ils n’imitent pas n’importe qui: c’est ce qui distingue, semble-t-il, les couples, les familles, et peut-être, ensuite, les groupes sociaux.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Or, pour découvrir tout ça, ce n’est pas une mince tâche. La plus longue étude en continu des perroquets dure depuis maintenant 25 ans... et on commence à peine à s’intéresser à leur langage.
Tout a commencé en 1985, quand l’écologiste californien Steve Beissinger, a constaté avec surprise qu’un couple de petits perroquets du Venezuela —appelés aussi perruches— s’était fait un nid sur un poteau de clôture d'une ferme, au Venezuela —alors que ces oiseaux s’installent d’habitude dans les hautes branches.
Il a donc eu l’idée de leur fabriquer des nids artificiels à partir de tuyaux de métal remplis de débris de bois. Et ça a marché: en 1987, des couples ont commencé à en faire leur maison. Il en a vite ajouté une quarantaine d’autres et, un quart de siècle plus tard, son expérience d’observation du comportement des Psittaciformes, de leur nom savant, se poursuit. Les couples s’y installent, les femelles y couvent leurs oeufs, les mâles apportent de la nourriture, les petits grandissent, et tout ce beau monde «parle». Steve Beissinger est devenu aux perroquets ce que Jane Goodall est devenue aux chimpanzés.
Avant d’en arriver au langage, il a toutefois fallu décoder leur vie de couple (ils sont fidèles dans leurs amours), apprendre à distinguer les familles (les nids sont numérotés, les petits sont bagués, etc.) et comprendre leur organisation sociale (parce qu’ils en ont une), toutes des choses qui avaient été impossibles à réaliser dans la nature. Ce n’est que récemment que le projet a commencé à s’intéresser à leurs talents de communicateurs.
Comme le rapporte ce reportage de la revue Science (réservé aux abonnés), une équipe menée par l’ornithologue Karl Berg, de l’Université Cornell, vient par exemple tout juste de publier une recherche démontrant que les «appels» de cet oiseau —les sons par lesquels il signale sa présence au milieu d’un groupe— ne sont pas innés. Il les apprend de ses parents.
C’est la première fois qu’on démontre l’apprentissage d’un son chez une espèce de perroquets sauvages.
Autre caractéristique: autant les mâles que les femelles apprennent —alors que chez la plupart des oiseaux chanteurs, seuls les jeunes mâles apprennent à chanter. De là à dire que le perroquet pourrait être un modèle de la façon dont les jeunes humains apprennent à parler...
Mais à part s’appeler pour signaler leur présence ou se retrouver, que se disent-ils? C’est là qu’on entre en territoire inconnu. Comme le résume un écologiste du développement cité dans l’article de Science: pourquoi un oiseau dépenserait-il autant d’énergie à apprendre tous ces sons? «Quel est l’avantage» que cela lui procure dans la nature? Trouvez la réponse à ces questions et vous saurez où chercher pour comprendre le «langage» des perroquets.
Par exemple, puisqu’il existe chez eux une hiérarchie sociale, le fait qu’ils s’imitent les uns les autres pourrait servir à distinguer les frontières des différents groupes —cet arbre est à nous, celui-là est à vous. Il reste beaucoup d’enregistrements à écouter et beaucoup de familles à voir grandir pour étayer cette hypothèse. Le perroquet n’a pas fini de fasciner.