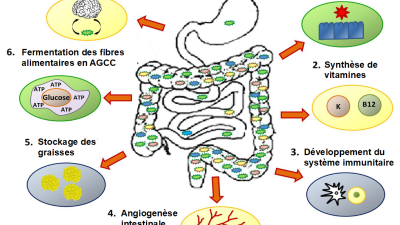Lorsque le corps a épuisé ses réserves de glucose lors d'un marathon, une étude montre qu'il puise ensuite son énergie dans la myéline qui entoure ses fibres nerveuses.
C'est une observation inattendue. Pourtant, un raisonnement simple au départ aurait pu nous amener à concevoir la myéline comme réservoir d'énergie. Nous savons depuis longtemps que la myéline qui entoure les axones des fibres nerveuses accélère la transmission de l'influx nerveux. Cette augmentation de la vitesse de l'influx doit donc faire intervenir de l'énergie supplémentaire. Ce supplément d'énergie pourrait se trouver dans cette substance. D'où le fait qu'elle puisse constituer un réservoir d'énergie. C'est ce qui a été observé récemment. Les résultats, publiés dans Nature Metabolism, ont montré que les signaux de myéline avaient diminué jusqu’à 28 % dans certaines régions cérébrales deux jours après un marathon. Les zones principalement concernées étaient liées au contrôle moteur et à la gestion des émotions. Autre point intéressant, la myéline dégradée avait pu être reconstituée complètement 2 mois après la course. Les résultats de l'étude ne montrent pas de dommage permanent au cerveau.
Cette découverte nous ouvre néanmoins la porte sur un nouveau champ d'investigation. Avec le vieillissement, les nerfs périphériques conduisent habituellement les influx nerveux plus lentement. Ce phénomène est lié, du moins en partie, à la dégénérescence des gaines de myéline. Dès lors, se pourrait-il que cette dégénérescence puisse s'expliquer par le fait que la myéline servirait de réservoir d'énergie à l'organisme, mais dans une moindre mesure que dans le cas d'une activité physique intense, et que, petit à petit, celle-ci ne serait pas reconstituée en totalité? Si c'est le cas, ce phénomène pourrait-il être lié, en partie, à une diminution du fonctionnement énergétique des mitochondries suite à une accumulation de mutations de leur ADN comme je l'évoquais dans mon article précédent? Ces dernières devenant moins aptes à fournir l'énergie nécessaire à notre organisme, la myéline serait appelée peu à peu à suppléer ce défaut pour les fonctions métaboliques habituelles.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Des cellules immunitaires impliquées dans la formation de réseaux cérébraux
Les microglies sont les cellules immunitaires du système nerveux central. Elles induisent la formation de synapses dans le cortex somatosensoriel en développement. Le contact des microglies avec les dendrites induit directement la formation de structures appelées filopodes, des protubérances des membranes des cellules nerveuses. Cette étude, publiée en 2016, par une équipe de l’Institut des sciences physiologiques à Okasaki au Japon, précise comment ces cellules immunitaires favorisent l’apparition de nouvelles connexions entre les neurones. Compte tenu de ce que nous savons maintenant sur le transfert des mitochondries des lymphocytes T, autre type de cellules immunitaires, bénéficiant à la croissance des tumeurs, nous pouvons imaginer que les cellules microgliales pourraient, elles aussi, transférer certaines de leurs mitochondries aux neurones pour la création de synapses. À nouveau, si cette hypothèse se confirmait, on aurait, ici aussi, un indice du fait que l'une des fonctions d'origine des cellules immunitaires a pu être celle de transporteurs d'énergie dans l'organisme tel qu'évoqué dans mon article précédent.