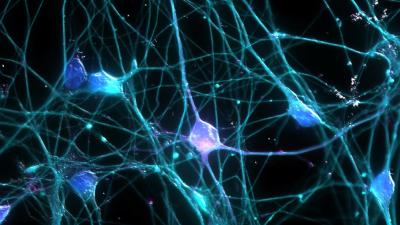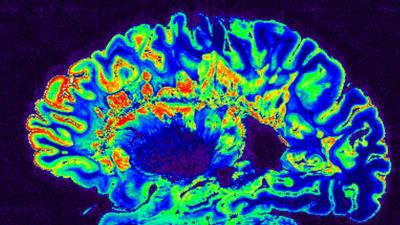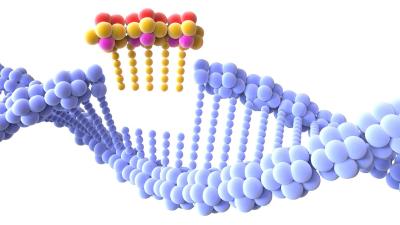Dans une réflexion intitulée «La sociologie de la désextinction», et parue le 25 mars dans PLoS Biology, la sociologue des sciences Carrie Friese et sa collègue Claire Marris proposent de s’éloigner du débat polarisé qui a eu cours jusqu’ici —les enthousiastes de la technologie d’un côté, et les inquiets de la nature de l’autre, et de recadrer le débat, en s’inspirant des discussions sur la meilleure façon —voire la légitimité— de préserver telle et telle espèce menacée. Quels intérêts (humains et autres) sont servis en faisant renaître cette espèce? À qui ou à quoi cela peut-il nuire? Sans compter deux importantes questions éthiques: à l’heure où on se soucie beaucoup plus qu’avant du sort des animaux de laboratoire, quel sera l’état de santé d’un animal produit à cette fin, quand on se rappelle combien est élevé le taux d’échecs autour du clonage? Et si ça marche, où vivra cet animal ?
La possibilité de ramener à la vie une espèce disparue, comme le mammouth, est entrée dans le discours public depuis deux ans, sous le terme peu ragoûtant de désextinction. Le clonage rend la chose plausible. Mais souhaitable?
Les plus populaires
Vérification éclair : un remède contre le cancer du pancréas ? Pas tout à fait
Lundi 16 février 2026
Les Jeux d’hiver 2026 seront-ils carboneutres?
Mercredi 18 février 2026
La nouvelle salve contre les vaccins à ARN
Vendredi 13 février 2026