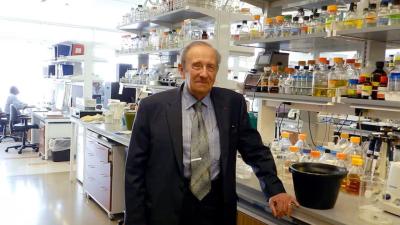Certains n’hésitent pas à faire le saut dans le débat, comme le philosophe Michel Seymour de l’Université de Montréal: «Droits de scolarité, destin de la chaîne culturelle de Radio-Canada, rapport au religieux. Je m’engage et je participe aux débats publics. Je le fais plus comme intellectuel que comme universitaire», nuance toutefois celui qui se qualifie non sans humour de «pelleteux de nuages lâché lousse dans l’univers des médias».
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
D’autres préfèrent plutôt s’abstenir, telle la sociologue Valérie Amiraux. «Notre parole est devenue indistincte et se noie dans le débat public», relève la spécialiste des questions de l’Islam de l’Université de Montréal.
Tous deux étaient invités à la plénière d’ouverture Où sont les universitaires? Savoirs et débats publics: une discussion entre sociologues et philosophes du colloque Philosopher en temps de crise lui-même piloté par la Société de philosophie du Québec dans le cadre du 82e congrès de l’Acfas.
Les philosophes seraient-ils plus hardis à participer que les sociologues? Il est vrai que deux images s’opposent trop souvent: celle de l’expert qui partage son savoir et celle de l’intellectuel engagé et radical. «L’expert prend actuellement toute la place du débat aux dépens de l’intellectuel vu comme un idéologue», annonce même la politologue et sociologue de l’UQAM, Maryse Potvin.
Les universitaires, qu’ils soient philosophes ou sociologues, disposent toutefois de plusieurs champs d’intervention publique. Ils peuvent répondre ainsi à la sollicitation d’ONG et de décideurs pour contribuer à des mémoires ou à l’élaboration de rapports et même participer à la rédaction d’ouvrages engagés, comme l’ont déjà fait Jocelyn Maclure (Laïcité et liberté de conscience, Boréal) et Michel Seymour (Une idée de l'université. Propositions d'un professeur militant, Boréal).
Intervenir ou pas
Alors qu’il serait intéressant de cartographier toutes les interventions possibles des intellectuels dans l’arène publique quelques obstacles se dressent pour refroidir les audacieux. Tout d’abord, la polarisation des débats rebute les universitaires habitués à mettre des nuances dans leurs propos.
Valérie Amiraux se bat ainsi contre les étiquettes réductrices et simplistes apposées par les journalistes: «Plus que de perdre ma neutralité, je dois lutter contre les fausses images. On m’a taxée d’“intellectuelle naïve” et même accusée de favoriser l’Islam», s’écrie la sociologue. Échaudée, elle choisit mieux à présent ses plateformes et ses combats.
Certains universitaires en appellent alors à faire de la Slow politics —et à lire l’ouvrage de Joseph Heath, Enlightenment 2.0. «Les crises sont souvent plus complexes que les médias veulent bien l’entendre et cela demande des interventions plus éclairées», rappelle Jocelyn Maclure. Le professeur à la faculté de philosophie de l’Université Laval raconte qu’il lui est même arrivé d’être «décommandé» par un journaliste qui avait réussi à trouver un intervenant plus polémique que lui!
Michel Seymour met plutôt au premier plan la surcharge des professeurs. «Sans compter que nos interventions sont bien éphémères —combien de personnes vont se souvenir d’un article publié dans Le Devoir?», soulève le philosophe. La première erreur serait toutefois, selon lui, de se décourager de prendre part au débat: «il importe de faire de la philosophie politique appliquée».
La crise environnementale dans l’œil du philosophe
Les philosophes et les experts ne parlent pas de la même façon de la crise environnementale. «Les premiers tiennent moins de propos catastrophiques que les seconds. Chez les experts, la fin du monde est déjà arrivée par la pensée», affirme la spécialiste de philosophie morale et politique, Catherine Larrère.
Lors de sa conférence La question environnementale: crise, catastrophe ou transition?, la professeure de philosophie de l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne rappelle que la crise —à l’origine, un terme médical— a basculé de la biologie à la sociologie et touche maintenant les questions sociales.
Parler de la crise, c’est surtout poser la question de la conscience et de la représentation que l’on a d’elle. «On ne peut parler de la crise de la disparition des dinosaures alors qu’on parle des changements climatiques comme d’une crise», relève-t-elle.
De la crise émerge, depuis 30 ans, une pensée écologique planétaire (Gaïa). Des penseurs, comme Michel Serres ( Le contrat naturel , Flammarion) recompose même les rapports de l’homme et de la nature. Et le glaciologue Claude Lorius déclare que l’anthropocène, c’est moins l’ère des humains que l’ère de la crise (Voyage dans l’anthropocène, Actes Sud, 2011).
La crise environnementale paraît insoluble. Peu de gens en envisagent la sortie. Les libertaires et les climatosceptiques auraient-ils raison de ne vouloir rien faire? Pas du tout. «Il faut maintenir l’ouverture du possible et inventer une nouvelle forme de démocratie verte», martèle Mme Larrère. Une sorte de transition écologique qui développerait une solution politique véritable et équitable.