
La méditation pleine conscience est censée nous guérir de notre anxiété et de notre dépression. Mais est-ce que ça fonctionne? Le Détecteur de rumeurs et l’Organisation pour la science et la société ont examiné ce que l’on en sait.
Cet article fait partie de la rubrique du Détecteur de rumeurs, cliquez ici pour les autres textes.
À lire également
Les origines de la rumeur
La méditation pleine conscience a ses racines dans le bouddhisme. On attribue son arrivée en Occident à l’Américain Jon Kabat-Zinn, qui en aurait pris connaissance par un conférencier au Massachusetts Institute of Technology, alors qu’il y faisait son doctorat. En 1979, Kabat-Zinn crée un Centre de réduction du stress à l’École de médecine de l’Université du Massachusetts, où il développe son désormais célèbre cours de huit semaines sur la réduction du stress par la pleine conscience.
Le but de la méditation pleine conscience n’est pas de se vider l’esprit. Il s’agit plutôt de s’exercer à prêter attention au moment présent, sans se juger. La respiration est souvent utilisée pour se concentrer. On intime à choisir un endroit du corps où on perçoit sa respiration, comme le nez ou la poitrine. Des idées, inquiétudes et regrets vont inévitablement se manifester: il faut reconnaître ces distractions et ramener son attention à la respiration.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
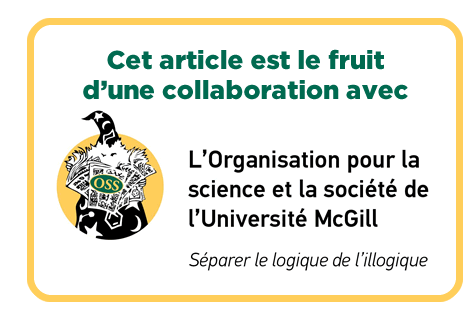 Avec le temps, la méditation est devenue une industrie: en 2015, celle-ci a dépassé le seuil du milliard de dollars, rapportait alors le magazine Fortune. Les revenus proviennent de conférences, de cours, de livres et d’applications censées guider le client à travers le processus. La populaire application Headspace affirme avoir eu 70 millions de téléchargements; en comparaison, l’application numéro 1 pour la méditation, Calm, en a plus de 150 millions.
Avec le temps, la méditation est devenue une industrie: en 2015, celle-ci a dépassé le seuil du milliard de dollars, rapportait alors le magazine Fortune. Les revenus proviennent de conférences, de cours, de livres et d’applications censées guider le client à travers le processus. La populaire application Headspace affirme avoir eu 70 millions de téléchargements; en comparaison, l’application numéro 1 pour la méditation, Calm, en a plus de 150 millions.
La difficulté à définir les mots
Mais est-ce que ça fonctionne? De nombreux scientifiques ont tenté de démontrer si la méditation pleine conscience contribue, comme le prétendent ses promoteurs, à atténuer non seulement la dépression et l’anxiété, mais aussi le TDAH, les douleurs, le manque de sommeil et les pertes cognitives, et ce dans tous les groupes d’âge.
Un des problèmes est de définir ce qu’on entend par « pleine conscience ». Dans son bestseller sur la méditation, How to Meditate, le psychothérapeute Lawrence LeShan indique que méditer peut être fait de plusieurs manières: arranger des fleurs, pratiquer un art martial, participer à une chorale religieuse… Comme le rapportait dès 2017 le journaliste Brian Resnick pour Vox, une étude scientifique avait testé une activité de coloriage de 15 minutes avec des enfants, activité qualifiée de « pleine conscience » par les chercheurs.
Cette approche peut aussi faire partie d’une thérapie de plus grande envergure, comme la thérapie d’acceptation et d’engagement. De sorte que si on y voit des bénéfices, est-on capable de distinguer s’ils sont causés par la composante « pleine conscience » ou par les autres parties de la thérapie ?
La recherche
Lorsque la méditation pleine conscience est testée dans des essais cliniques randomisés, chaque participant se fait assigner un des deux groupes : le groupe pleine conscience et le groupe témoin —c’est-à-dire celui qui ne reçoit aucune thérapie. Parfois, le groupe témoin est actif, ce qui signifie que ses participants reçoivent une autre forme d’intervention. Mais souvent, le groupe témoin est passif.
La surprise: la méditation pleine conscience est rarement supérieure à un groupe témoin actif. Plusieurs auteurs des revues de la littérature sur le sujet rapportent que certaines des études ont conclu que cette méditation a un petit bénéfice lorsqu’on la compare aux participants de groupes témoins, mais ajoutent que le bénéfice disparaît lorsque la comparaison se limite aux groupes témoins actifs.
La conclusion ici semble donc être que de faire quelque chose est mieux que de ne rien faire.
La recherche a aussi révélé les limites des applications pour téléphones que certains utilisent pour guider leurs méditations: dans le contexte d’une étude publiée en 2023, un quart des participants les avaient abandonnées en cours de route (ce nombre est similaire à ce qu’on observe avec les applications en santé mentale). En-dehors des projets de recherche, les chiffres sont peut-être plus mauvais encore: des milliers de gens qui avaient choisi de s’abonner pendant un an à l’application Calm ont été suivis dans le temps et plus de la moitié de ceux-ci avaient abandonné l’application dans la première année. Pour ceux qui avaient poursuivi, leur méditation était d’en moyenne moins de quatre minutes par jour.
Des bémols
Plusieurs participants rapportent que la méditation pleine conscience fonctionne pour eux. Le bénéfice perçu pourrait en théorie s’expliquer par une pratique de longue durée, alors que les études tendent à être de courte durée. Si les effets positifs de la pratique prennent effectivement des années à se manifester, il est improbable qu’ils seront découverts par ces recherches.
Mais il est également possible que cette méditation améliore un résultat composite, c’est-à-dire un agrégat de plusieurs évaluations comme l’anxiété, la dépression et le stress. Par exemple, une méta-analyse publiée en 2022 concluait que la méditation fonctionne bien chez les adolescents à l’école secondaire lorsqu’on regarde un résultat composite… mais ces bénéfices disparaissent lorsqu’on se concentre uniquement sur l’anxiété ou la dépression.
Enfin, il est possible que l’âge fasse une différence: adolescents et jeunes adultes ne réagissent pas toujours de la même façon.
Verdict
Les données sont maigres pour affirmer que la méditation pleine conscience est plus efficace qu’une thérapie normale, ou pour distinguer ses effets de ceux des autres gestes que pose une personne pour combattre son anxiété. La difficulté à définir la méditation pleine conscience complexifie également les études.
Cet article est une adaptation du texte en anglais de Jonathan Jarry publié sur le site de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill.












