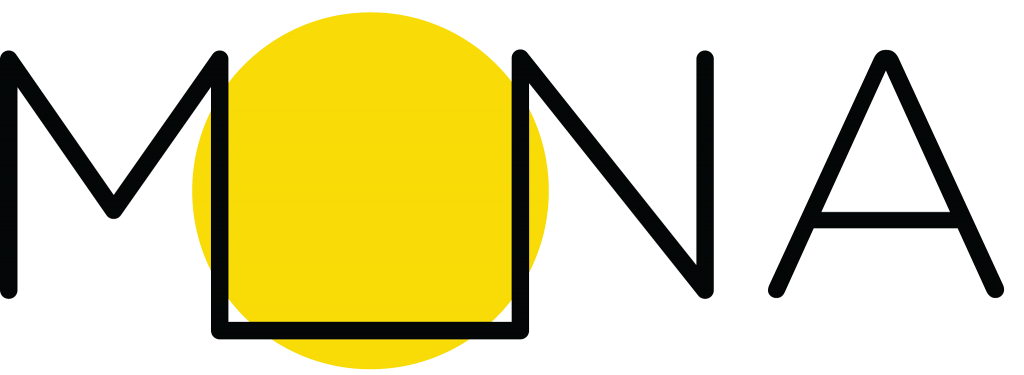Montréal a inauguré en 2018 une murale de l’artiste atikamekw Meky Ottawa en hommage à la cinéaste abénaquise Alanis Obomsawin. La murale rejoint les rares œuvres autochtones disséminées dans les rues de la métropole. Les créateurs autochtones sont toutefois de plus en plus nombreux à chercher des manières d’affirmer artistiquement leur présence dans la ville en réalisant des œuvres au message fort et souvent engagé.
Au Québec, près de la moitié de la population autochtone réside en ville et non dans les réserves [1]. Ainsi, environ 10 500 personnes provenant des 11 nations du Québec et d’autres nations autochtones du Canada habitent Montréal. L’expérience urbaine est souvent difficile pour les populations autochtones, car elle implique de troquer un territoire traditionnel et une vie en communauté pour un lieu anonyme au sein duquel l’intégration n’est pas toujours évidente [2]. Par le biais d’œuvres présentées dans l’espace public, telles que la murale de Meky Ottawa consacrée à Alanis Obomsawin (voir la figure 1), la création artistique peut être une manière pour les membres des nations autochtones de se faire une place et de marquer visuellement la ville de leur présence.
S’inscrire dans les rues de Montréal
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
La ville de Montréal accueille 67 % des lieux de diffusion en arts visuels au Québec [3], ce qui explique la forte concentration d’artistes autochtones à Montréal, même si leur visibilité y demeure faible. L’art public à Montréal est subventionné par les politiques d’art public de la Ville ainsi que par des organismes tels que le MU ou des festivals (le festival MURAL, par exemple). Or, ce n’est que depuis quelques années que ces organismes, privés ou publics, ont commencé à donner une visibilité aux créateurs autochtones. En outre, la Ville de Montréal encourage les initiatives artistiques hors les murs (c’est-à-dire en dehors des institutions habituelles), notamment dans les rues et sur les immeubles. L’espace public apparaît dès lors être une manière pour les artistes autochtones de s’inscrire artistiquement dans la ville sans nécessairement avoir à faire face à l’institutionnalisation de certaines structures muséales.
La ville est également le lieu d’une rencontre entre plusieurs nations autochtones. En effet, le Québec compte 11 nations distinctes, englobant les Premières Nations et les Inuits, qui vivent dans des territoires particulièrement éloignés et qui ont peu d’occasions de se fréquenter. L’espace urbain devient un « lieu de ralliement [4] » pour différentes cultures autochtones qui sont amenées à se côtoyer, à tisser des liens ou encore à réaliser des collaborations, artistiques ou non. Ainsi, inaugurée le 5 novembre 2018, la murale d’Alanis Obomsawin, issue de la nation abénaquise, a été réalisée par une artiste atikamekw, ce qui a encouragé un dialogue entre les cultures. L’anthropologue Laurent Jérôme parle de « panamérindianisme », c’est-à-dire d’un « mouvement de rencontre, d’échanges et d’emprunts culturels et rituels entre différentes nations autochtones [5] ». La murale est donc une manière de rendre hommage à une figure phare tout en attestant d’une continuité et d’une transmission aux jeunes générations et aux artistes de la relève, ce dont témoigne le choix d’une jeune artiste atikamekw pour sa réalisation.
Honorer une figure emblématique
Si les murales permettent de souligner la présence de cultures peu visibles au quotidien à Montréal, elles donnent également l’occasion de contrecarrer l’image parfois péjorative accolée aux nations autochtones. En effet, les actualités concernant les Autochtones mettent souvent l’accent sur les événements négatifs ou les faits divers. Les murales semblent ainsi faire le contrepoids de cette vision médiatique, offrant la possibilité aux Allochtones* de changer le regard qu’ils portent sur les Premières Nations [6].
La murale de Meky Ottawa représentant Alanis Obomsawin a peu fait parler d’elle, alors qu’elle s’inscrit dans la série « Bâtisseurs culturels montréalais » commanditée par le MU et dont fait également partie la célèbre murale de Leonard Cohen (rue Crescent). L’œuvre véhicule pourtant un message fort en honorant Alanis Obomsawin, une réalisatrice de la nation abénaquise ayant filmé et documenté des événements marquants de l’histoire autochtone du Québec (la crise d’Oka*, les pensionnats*) [7]. Alanis Obomsawin est ainsi une figure emblématique de l’histoire contemporaine autochtone et des mouvements activistes, qualifiée de « [f]emme de conviction, de courage, d’engagement, de résistance » par la directrice de MU, Elizabeth-Ann Doyle [8]. Sa collaboration avec l’Office national du film (ONF) et son activisme en font l’une des cinéastes autochtones les plus connues aujourd’hui, même si elle l’est peu du grand public québécois.
Sur la murale, les enfants placés les uns derrière les autres font référence à son premier documentaire, Christmas at Moose Factory (1971). Tourné dans un pensionnat près de la baie James, il présente les dessins de jeunes Autochtones qui racontent leur histoire. Se passant de mots, l’œuvre hommage à Alanis Obomsawin évoque en silence une histoire qui lui est propre ; le tambour ainsi que les motifs traditionnels végétaux représentés incarnent également un récit et une culture.
La géographe canadienne Evelyn J. Peters s’est intéressée aux moyens employés par les Autochtones vivant en milieu urbain afin de se réapproprier la ville [9]. L’espace urbain réinvesti par des productions artistiques de grand format, telles que des murales, permet de diffuser un langage visuel accessible et visible par tous. En effet, les Allochtones, de manière générale peu informés du quotidien des Premières Nations, développent souvent une image stéréotypée de l’autochtonie [10]. La création d’œuvres publiques fait donc résonner les voix autochtones dans un paysage médiatique encore largement favorable aux clichés et aux stéréotypes.
De plus, certaines murales viennent rappeler ou dénoncer des réalités actuelles encore largement ignorées. À cet égard, les murales situées dans le centre de Montréal White Supremacy is Killing Me (2017) de l’artiste colombienne Jessica Sabogal et Justice pour les femmes autochtones disparues et assassinées (2014) de Fanny Aishaa (voir la figure 2) viennent dénoncer les rapports de domination liés à la suprématie blanche ainsi que le sort des femmes et filles autochtones disparues ou assassinées. La murale de Fanny Aishaa fait ainsi référence au risque trois fois plus élevé pour les femmes autochtones d’être victimes de violences ou d’un homicide ; une enquête publique nationale sur ces disparitions a d’ailleurs vu le jour en 2015 [11]. La murale devient alors un outil de revendication, de mise en avant d’une réalité qui a longtemps été ignorée.
Paradoxalement, malgré la visibilité offerte par les murales, force est de constater à quel point ces œuvres sont peu nombreuses à Montréal. L’étude conjointe du Conseil des arts de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal, intitulée Pratiques professionnelles en arts visuels issues de l’autochtonie et de la diversité à Montréal (2017), témoigne de cette marginalisation des artistes autochtones en arts visuels. Le Québec ne sort pas gagnant d’une comparaison avec les autres provinces canadiennes, notamment la Colombie-Britannique, qui se fait un point d’honneur à mettre de l’avant les productions des nations autochtones de la côte Ouest [12].
Par ailleurs, la majeure partie des projets artistiques autochtones dans la ville sont des projets éphémères. Ainsi, les projets présentés lors du festival Présence autochtone ou à l’occasion d’expositions à ciel ouvert, comme Sentier de résilience ou Territoires en 2017, n’avaient pas vocation à demeurer dans la ville. Une œuvre éphémère n’a donc ni la même visibilité ni le même effet qu’une œuvre d’art public pérenne.
Malgré un chemin pavé de bonnes intentions, le public montréalais se heurte à diverses difficultés s’il veut côtoyer des œuvres autochtones et les comprendre. En effet, bien souvent, l’appellation générique culture autochtoneest employée au singulier, ce qui nie les spécificités culturelles de chaque nation. À titre d’exemple, le Mât totémique de pensionnat, œuvre installée devant le Musée des beaux-arts de Montréal et prêtée dans le cadre des 375 ans de la fondation de la ville de Montréal, a été réalisé par l’artiste kwakwaka’wakw (kwakiutl) Charles Joseph de Colombie-Britannique. L’œuvre est donc l’expression des nations de la côte Ouest et non de celles du Québec [13]. Des initiatives de ce type, malgré leur bonne foi, contribuent à alimenter une certaine confusion et sont représentatives de la difficulté des Premières Nations de l’Est à faire reconnaître leur présence et leurs singularités.
« Décoloniser » l’espace urbain
Ces dernières années, la Ville de Montréal a entrepris une valorisation de la présence autochtone. Par exemple, en 2017, elle a modifié son drapeau afin d’ajouter un pin blanc en son centre, reconnaissant ainsi les racines autochtones de son territoire. D’autres initiatives visent à décoloniser les espaces en restituant, par exemple, les toponymes originels. Plusieurs lieux portent désormais des noms mohawks en reconnaissance de l’histoire de la ville, notamment le parc au sommet d’Outremont sur le mont Royal, rebaptisé Tiohtià:ke Otsira’kéhne.
Les œuvres d’art public contribuent à cette décolonisation de l’espace. Parce qu’elles réinvestissent des lieux, elles permettent une affirmation culturelle et incitent les créateurs autochtones à prendre symboliquement et physiquement leur place dans la ville. Peuplée de ces œuvres, celle-ci devient un espace d’innovation mais également de résistance [14]. Bien que les initiatives soient encore peu nombreuses, la Ville de Montréal semble se tourner vers une démarche de mise en avant des créateurs autochtones au sein de l’espace urbain. Ces mesures sont d’autant plus pressantes que, selon l’étude de 2017 citée précédemment, la population montréalaise demeure trop peu exposée aux cultures autochtones et présente un pourcentage élevé de « sceptiques indifférents [15] ». Ce terme fait référence à des personnes complètement désintéressées des questions et des réalités autochtones et qui considèrent ces nations comme faisant partie de la population québécoise, n’ayant pas de cultures qui leur seraient propres. En prenant leur place dans le tissu urbain montréalais, les créateurs autochtones jouent donc un rôle majeur dans la déconstruction des stéréotypes et des images préconçues, et ils viennent accentuer le caractère cosmopolite et innovant de la ville. Leurs créations artistiques, particulièrement celles accessibles à tous comme l’art public, encouragent le dialogue et l’apprentissage. L’œuvre publique développe alors un pouvoir certain, celui d’être à la vue de tous, de témoigner de souffrances silencieuses ou occultées tout en véhiculant une présence artistique vibrante par le biais d’œuvres colorées, respectueuses et poignantes.
— Clara Ruestchmann, étudiante au programme de maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Montréal
Encadré — Les 11 nations autochtones du Québec
Pour plus d’informations sur les nations et les cultures autochtones : https://www.tourismeautochtone.com/apprendre/nations/