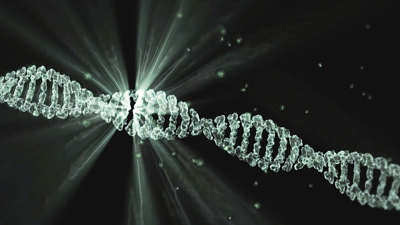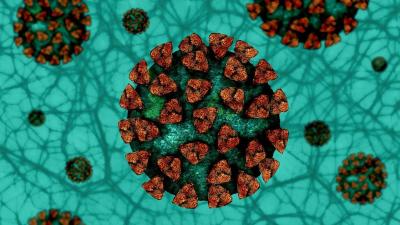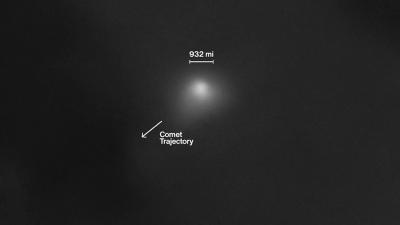On a peine à croire qu’en 2003, le New England Journal of Medicine se soit réjoui, en éditorial, de ce que le nouveau virus du moment, le SRAS, ait fait l’objet d’une mobilisation scientifique internationale, qui avait conduit au séquençage de son génome en seulement un mois. Aujourd’hui, une semblable mobilisation ne vaut même plus une note de bas de page.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Au contraire, dans l’édition du 5 juin du même New England Journal of Medicine, trois pontes de la recherche en virologie publient une réflexion sur la possibilité que le nouveau H7N9 ne devienne une pandémie mondiale: ils comparent les chiffres —132 cas recensés et 37 morts, tous en Chine— avec ceux de grippes aviaires antérieures, et mettent sur le tapis la liste des informations dont disposent les experts, et celles qui manquent pour faire des prédictions éclairées. Cette fois, la liste semble davantage pencher du côté du savoir que de l’ignorance.
Il en ressort que les virologues et autres généticiens sont capables de pointer avec de plus en plus de précision les facteurs qui, à l’intérieur des gènes du virus, font qu’une grippe aviaire —donc, d’ordinaire réservée aux volatiles—puisse infecter un humain. En revanche, on reste incapable de prédire avec quelle fréquence un tel virus mutant peut devenir endémique entre humains, mais ce sont justement ces facteurs génétiques qui tendent à rassurer :
Considérant le fait que des millions d’humains soient potentiellement exposés chaque jour à diverses souches de grippes aviaires, la grande rareté de nouvelles adaptations aux humains de ce virus suggère qu’en dépit d’une faible barrière inter-espèces à l’infection, les barrières contre une infection productive et transmise à grande échelle doivent être très élevées.
L’article poursuit en énumérant quelques raisons possibles : par exemple, parmi les 17 types connus de «H» (hémagglutinines) et les 10 types connus de «N» (neuraminidases), seulement une petite poignée de combinaisons (dont H1N1, la plus connue) se sont adaptées à une transmission entre humains, depuis 95 ans qu’on observe la chose. Et la fréquence de ces pandémies suggère des cycles liés aux changements de générations chez les humains qui ont survécu.
On est loin de l’époque où un cousin de cette grippe, appelée alors espagnole, avait pu faire des dizaines de millions de morts avant même que la médecine n’ait compris ce qui lui tombait dessus. La liste des 69 articles écrits en quelques semaines sur le H7N9 est un catalogue du niveau de spécialisation: étude sérologique, phylogénétique, anticorps, soins infirmiers, mesures sanitaires dans les marchés publics, en plus de la réponse des autorités dans une ville, dans une région, ou dans un pays, par des chercheurs des quatre coins de la planète. Le virus réserve sûrement des surprises, mais il n’aura jamais été scruté par autant d’yeux à la fois.