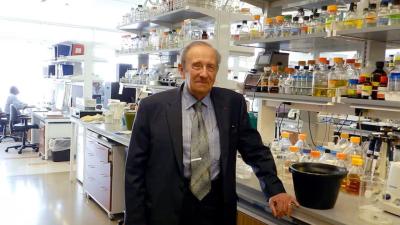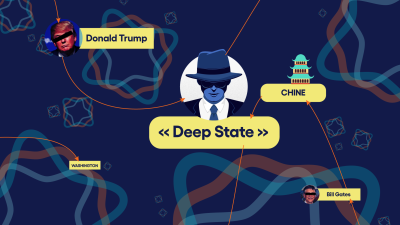Cet article fait partie de la rubrique du Détecteur de rumeurs, cliquez ici pour accéder aux autres textes.
Autrement dit, il est loin le temps où un politicien pouvait être embarrassé par une étiquette « faux » collée sur sa déclaration de la veille. Les verdicts « plutôt vrai » ou « plutôt faux » seront donc montés en épingle et les autres, balayés sous le tapis.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Rosenstiel faisait ce constat dans une conférence donnée lors du congrès international des médias vérificateurs de faits (Global Fact 4) qui avait lieu au début du mois à Madrid (voir nos deux autres articles, ici et ici). Mais loin d’être un constat pessimiste offert aux « fact-checkers » d’une soixantaine de médias présents, c’était d’une opportunité dont ce spécialiste de la critique des médias voulait leur parler : celle de réinventer la vérification des faits, de l’éloigner de la confrontation d’une déclaration politique, pour l’orienter vers une vérification davantage « centrée sur le problème » (issue-centric) que « centrée sur l’acteur (actor-centric) ». Une vérification qui, incidemment, ressemble davantage à ce qui se fait déjà en journalisme scientifique.
Un peu d’histoire
La vérification des faits a beau être une partie intrinsèque du travail de tout journaliste, le mouvement tel qu’on le connaît aujourd’hui n’a connu ses balbutiements qu’au début des années 1990 — le fact-checking 1.0, dans les mots de Rosenstiel. Après une éclipse, il est revenu avec les sites FactCheck en 2003 et surtout PolitiFact en 2007. Ceux-ci ont cimenté le « fact-checking 2.0 » : des verdicts (vrai, faux, ou entre les deux), des indicateurs parfois ludiques (les « Pinocchios » du Washington Post), des « données structurées » pour appuyer le tout, et même de la vérification en direct lors de discours politiques.
Or, une décennie plus tard, le mouvement est entré dans une zone de turbulences. D’une part, personne n’aurait pu prévoir en 2007 que les nouvelles les plus partagées de la campagne électorale américaine de 2016 seraient des fausses nouvelles. D’autre part, s’il est inévitable qu’un candidat déteste voir ses déclarations être vérifiées — et qu’il adore « quand l’autre type se fait vérifier » — on avait sous-estimé la capacité des politiciens à s’adapter : ils « anticipent » ce qui sera soumis à une vérification, et ils l’exploitent à leur avantage, juge Rosenstiel pour qui les vérificateurs « n’en sont généralement pas conscients et sont mal équipés pour défendre leur travail ».
Un des problèmes est que cette vérification telle qu’on la connaît est née du désir de rendre les élus encore plus redevables devant l’électeur, et qu’elle tourne donc largement autour des politiciens. En fait, la majorité des 126 initiatives de 49 pays recensées par l’International Fact-Checking Network, couvrent la politique. « L’unité atomique de la vérification des faits, c’est la déclaration », ce qui limite souvent la vérification à quelque chose de « trop littéral, trop factuel » : un chiffre, une date, un mot.
Ce que propose Tom Rosenstiel — qui est notamment l’auteur de The Elements of Journalism, sur les relations entre journalisme et démocratie, traduit en plus de 25 langues — c’est de concevoir une vérification qui examinerait davantage le contexte dans lequel s’inscrit cette déclaration, le message sous-jacent. « Une vérification qui serait centrée sur le problème (issue-centric) placerait le tout dans une perspective plus large. » Interrogé à ce sujet après sa conférence, Rosenstiel convient que le journalisme scientifique est, de par la nature de ses sujets qui ne sont ni noir ni blanc, d’ores et déjà obligé d’examiner et d’expliquer le contexte et qu’il ne peut pas autant se contenter de confronter une déclaration que le journalisme politique.
Il voit aussi dans ce « fact-checking 3.0 » une façon d’amener le public à mieux comprendre l’ensemble d’un problème : « Identifiez quatre à six idées-clefs que les gens doivent connaître pour comprendre ce problème… et [identifiez] où réside de la confusion ». Ça pourrait même être, disait-il en entrevue en mars dernier, « une façon d’aider à regagner la confiance du public ».
Quant au journaliste lui-même, cela lui permettrait d’être davantage proactif : « quels sont les éléments de confusion autour de ces questions, et qu’est-ce que les gens ont besoin de savoir ? » Alors que traditionnellement, la vérification des faits a souvent été « en réaction » à une déclaration ou à une controverse.
Sans compter que ça peut devenir une façon de contourner la partisanerie : plutôt que de dire « votre candidat a menti », on amène le lecteur à réfléchir au problème dans un contexte plus large.
« Vous allez peut-être détester ça », a-t-il conclu en s’adressant à ces vérificateurs dont il venait de secouer certaines convictions sur leur méthode de travail. À en juger par le groupe qui s’est formé autour de lui pour en discuter après sa conférence, sa vision a toutefois touché une corde sensible.