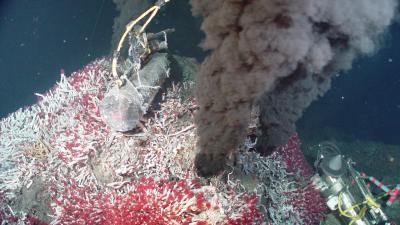De tous les hommages rendus cette semaine à Jane Goodall, l’un d’eux renvoie à l’impact le plus lourd de conséquences qu’a eu l’anthropologue la plus célèbre du monde: ce renversement de perspective dans la façon dont nous regardons les animaux.
À lire également
En observant en 1960 que les chimpanzés pouvaient utiliser un outil —une brindille qu’ils avaient débarrassée de ses feuilles et plongée dans une termitière pour en ramener les insectes— elle allait à l’encontre d’une idée bien ancrée, mais que le philosophe René Descartes avait réduite en 1637 à une équation simple: les animaux, disait-il, n’ont pas d’âme. Ils sont en quelque sorte des machines complexes et en conséquence, l’humain est autorisé à s’en servir comme bon lui semble.
Avec l’observation de la brindille, Goodall n’ouvrait pas seulement la porte à une redéfinition du mot « outil » et du mot « humain », comme le lui avait suggéré le paléoanthropologue britannique Louis Leakey, dans un télégramme où il réagissait à son observation. Goodall ouvrait la porte à repenser notre regard sur ce qui nous différencie des animaux.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Il deviendrait rapidement clair que les chimpanzés, et avec eux les grands singes, ont des émotions et des personnalités. Ultimement, il faudrait ajouter un chapitre à la définition de ce qu’est « l’intelligence ». Un demi-siècle plus tard, la liste des animaux capables de performances qu’on n’aurait pas cru possibles continue de s’allonger.
Charles Darwin avait ouvert cette porte en 1872 dans son livre moins connu The Expressions of the Emotions in Man and Animals, où il tentait d’expliquer l’évolution des expressions faciales chez les animaux et les humains. Les prédécesseurs du mouvement écologique, avant les années 1960, avaient également ouvert la porte à une redéfinition de nos rapports avec les animaux. Mais il faudrait les observations sur le terrain de Jane Goodall auprès des chimpanzés et de Dian Fossey auprès des gorilles pour progressivement effacer cette ligne de séparation dogmatique, plus religieuse que scientifique, entre humains et animaux.
Goodall est par la suite devenue la championne que l’on connaît de la défense des grands singes et de l’environnement en général. Ses conférences et les ateliers créés à l’intention des jeunes biologistes, sont devenus sa contribution, aux quatre coins du monde. Elle a publié 32 livres, dont 15 pour les jeunes. L’Institut Jane Goodall, fondé en 1977 et aujourd’hui présent dans 25 pays, est devenu un organisme voué à la conservation de la nature. Dans un de ses textes, publié en 2002 par le magazine Time, elle écrivait que « le plus grand danger pour notre futur, est notre apathie ».
À présent que nous regardons finalement en face les terribles dommages que nous avons infligés à notre environnement, notre ingéniosité travaille à fond pour trouver des solutions technologiques. Mais la technologie à elle seule n’est pas suffisante. Nous devons aussi nous engager avec nos coeurs.
Jane Goodall est décédée le 1er octobre en Californie, à l’âge de 91 ans, au milieu d’une de ces tournées de conférences.
Le message de Jane Goodall, sur le site du magazine The New Scientist