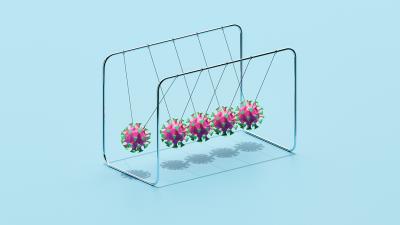« J’ai fait plus de 1000 interventions » pendant la pandémie, raconte Alain Lamarre, de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). « Soit plus d’une douzaine par jour, de 6 heures du matin jusqu’à tard en soirée. Je n’ai pas de mérite, c’est mon domaine de recherche. Cela a été mon effort dans la crise, avec le sentiment d’avoir fait œuvre utile. »
Le chercheur en immunologie et virologie, qui avait jadis fait son doctorat sur les coronavirus, est en effet devenu une figure connue, sous la pression de collègues qui le référaient, et des demandes continues des médias. Vendredi dernier, il prenait à nouveau la parole, mais cette fois lors d’un colloque sur « Les effets de la pandémie sur la médiatisation de la science », dans le cadre du congrès de l’Acfas. « Au début de la pandémie, on ne pouvait pas faire de recherche et j’ai compensé en prenant la parole dans l’espace public. »
Et il n’est pas le seul. Depuis deux ans et demi, de nombreux scientifiques québécois sont ainsi sortis de leur laboratoire pour parler de science dans les médias: de virus, de vaccins, de gestes barrières, mais aussi de la façon dont la science se construit.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
« Lorsqu’on parle d’une étude, il faut aussi expliquer sa portée et ses limites pour bien éclairer le public. Qu’un scientifique soit capable de l’expliquer, cela enrichit le débat et cela permet à la recherche d’être mieux comprise », signale Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
Pour une science non partisane
Ça n’a pas toujours été facile. Crise sanitaire oblige, le discours scientifique circulant dans les médias et dans l’espace public s’est transformé pour se simplifier et se politiser. « Le grand public voulait une réponse courte et directe alors que nous avions plusieurs réponses (A, B et C) à lui donner. Un mètre de distanciation ou deux mètres ? La science ne prend pas position —une notion qu’il est difficile de transmettre aux gens », convient le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion.
Et ce qui n’a peut-être pas aidé pendant la pandémie, c’est que « certains chercheurs ont cohabité avec les politiciens et les journalistes, et je ne serais pas surpris que cela ait eu un effet quant à la perception des scientifiques, pour le meilleur ou pour le pire », relève le philosophe des sciences et doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, Frédéric Bouchard. « L’affirmation de Justin Trudeau, « Je crois en la science », ça invite à la partisanerie. L’étiquette « pro science », ça pousse à penser que les autres sont « anti science ». La science devrait être un élément de décision et pas un élément partisan. »
Marc A. Bonnet, chercheur en sciences juridiques à l’Université Laval, renchérit là-dessus en rappelant que la science n’est pas une religion et donc, on ne peut y « croire ». On doit s’appuyer sur la méthode scientifique et on peut avoir confiance en une expertise, mais il faut se méfier de la politisation de la science », soutient-il lui aussi.
L’expertise dans le débat public
Cela n’a pas non plus été facile en temps de pandémie, parce que les connaissances scientifiques se construisaient en temps réel, rappelle Marine Corniou, journaliste à Québec Science. « Nous étions dans la réaction, sans avoir le « background » nécessaire. C’est l’inverse de notre travail habituel. Mais nous n’avions pas le choix de le faire, et il fallait le faire de manière très rapide.»
Normalement, « les débats autour de la méthodologie et des échantillonnages » sont ce qui est important en santé publique, souligne Luc-Alain Giraldeau, directeur de l’INRS. Mais « est-ce réaliste de donner tout ça au public pour qu’il soit capable d’en débattre? »
« Ce dont on veut discuter, c’est plutôt du résultat. Les gens, pour être capables de comprendre, doivent soit accepter de faire un post-doc, soit faire confiance aux spécialistes. Il est là, le débat. »
La montée de la désinformation
L’autre problème de taille a été la montée de la désinformation sur les réseaux sociaux. « Les mauvaises nouvelles circulent plus que les bonnes et prennent plus de place », rappelle le doctorant en biologie de l’INRS, Martin Chenal. Et là-dessus, les jeunes chercheurs ont sans doute un rôle à jouer, reprend Alain Lamarre : sur les réseaux sociaux, « moi, j’ai peu d’influence, mais les jeunes y sont », relève le chercheur de l’INRS.
Martin Chenal pense pour sa part que le meilleur moyen de lutter contre la désinformation serait d’inonder les gens de bonnes informations scientifiques. « Les exposer ainsi va peut-être les rendre moins catégoriques », croit celui qui est producteur d’un petit journal de vulgarisation scientifique, La Synthèse.
Une mission pas facile, poursuit-il, en raison d’une espèce d’ « incompatibilité du discours scientifique et de la désinformation. Avec cette dernière, il n’y a souvent pas de place à la discussion », note-t-il.
Cette mouvance s’inscrit d’ailleurs dans quelque chose qui dépasse la science et qui est dangereux, relève la journaliste Marine Corniou. « Il y a presque une revendication politique de dire que je ne crois pas en la science. » Dans le contexte de la montée du populisme, « la science peut être ainsi instrumentalisée ».
Comme son collègue journaliste Jean-François Cliche, qui participait au même panel, elle assure qu’elle persistera à faire son travail malgré une agressivité grandissante dans la sphère publique et sur les réseaux sociaux. « Certaines personnes considèrent les journalistes biaisés ou corrompus, alors c’est parfois décourageant. Malgré tout, j’ai envie de bien faire mon travail sans me démotiver, mais je crains un peu ce clivage », soutient encore la journaliste.
Les sciences sociales à la rescousse
Injecter plus de sciences sociales pourrait-il aider? « Il nous faut trouver de nouvelles façons de faire », convient Rémi Quirion. En plus des experts en virologie ou en épidémiologie, on aurait dû avoir une présence plus grande des experts en santé mentale et en sciences sociales. »
L’urgence et le manque de temps ont joué. « Nous allons apprendre de ça et du climat sociétal aussi, pour trouver des façons différentes de nous adresser aux citoyens. Il va falloir aussi augmenter la littératie scientifique. C’est une leçon pour les fonds de recherche et les gouvernements », note le scientifique en chef.
Frédéric Bouchard avance également que, du côté des solutions, il faut élargir la table à plus de diversité d’opinions. « Il importe de s’intéresser à la relation de confiance. Il y a plusieurs groupes qui n’ont plus confiance envers les institutions parce qu’ils ont été maltraités dans le passé. »
Cela passerait par plus de diversification des cohortes étudiantes. Et sans doute aussi, par une plus large représentativité dans le corps professoral et le monde de la recherche.
Mais le philosophe des sciences revient encore sur la nécessité de maintenir une séparation entre l’expertise et le politique. « Pour réaffirmer cette confiance, on doit également retrouver une plus grande autonomie, perçue ou réelle. Il y a d’une part les avis des experts et d’autre part, les décisions de la collectivité. Cela demande de laisser décider les élus d’utiliser cet outil qu’est la science. Et aussi de mieux armer nos chercheurs qui doivent participer aux débats publics. »
Photo: Lauren Gardner, de l'Université Johns Hopkins, dont le groupe a conçu l'outil de suivi numérique de la COVID.