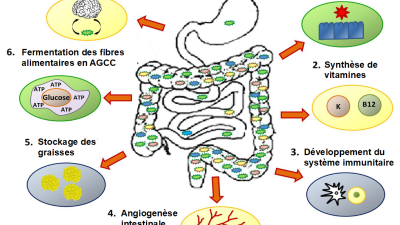Petit à petit, des études suggèrent que le cerveau humain pourrait faire appel à des phénomènes quantiques pour son fonctionnement. Il y a près d'une trentaine d'années déjà que Roger Penrose, prix Nobel de physique, avait proposé cette idée. Rappelons que la physique quantique, domaine habituellement réservé à la physique atomique, à la physique nucléaire et à celle des particules, est caractérisée par deux propriétés absentes à notre échelle : la superposition et l'intrication.
Laissons de côté ici l'intrication pour rappeler que la superposition est cette propriété en vertu de laquelle un objet, ou plus généralement un système, se retrouvent simultanément dans différentes configurations ou différents états. C'est cette fameuse superposition si mystérieuse qui a abouti à la naissance des qubits dans les ordinateurs quantiques, toujours en phase de développement.
Lorsque Penrose a suggéré que le cerveau humain devrait faire intervenir des phénomènes de nature quantique au milieu des années 1990, cette idée s'est heurtée à diverses critiques. La principale repose sans doute sur le phénomène de décohérence : des atomes ou des particules qui se trouvent dans un tel état de superposition perdent cette propriété à la moindre perturbation constituée, par exemple par le mouvement de quelques atomes ou particules extérieurs au système et interagissant avec celui-ci. D'où habituellement la nécessité de maintenir ces systèmes à des températures proches du zéro absolu. Le cerveau humain fonctionnant à la température ambiante, on ne voyait pas comment de tels qubits biologiques pouvaient exister.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Et pourtant, coup sur coup, trois études osent remettre en question ce postulat. En 2022, la publication de résultats obtenus par des scientifiques de l’Université de Dublin suggère que nos fonctions cérébrales cognitives reposeraient sur le calcul quantique. Puis, l'an passé, en avril 2024, une autre équipe aurait mis en évidence un autre type de phénomène quantique qu'on nomme la superradiance. Les chercheurs auraient démontré que ce phénomène peut exister dans les neurones, là où l'on pensait auparavant qu’il était impossible.
Or, toujours en 2024, une autre équipe a pu démontrer cette fois qu'il est possible à un système de se trouver dans un état de superposition quantique à température ambiante. Certes, cet état n'a perduré que pendant une durée extrêmement brève de 100 milliardièmes de seconde. Il n'en demeure pas moins que ce résultat constitue un pas de géant en la matière.
Ces trois études ne constituent que les premiers pas vers ce qui pourrait s'avérer être la mise au grand jour de l'une des plus extraordinaires aptitudes du cerveau, autant sur le plan physique, que biologique et finalement cognitif.
Avec tout cela, la question à se poser ne serait pas tant de savoir si le cerveau humain est l'analogue d'un ordinateur quantique, mais plutôt de se demander si notre organe de la cognition ne pourrait pas articuler, à travers son fonctionnement, à la fois un mode de calcul quantique à celui, classique, des réseaux neuronaux. C'est du moins, ce à quoi nous amène, comme interrogation, une réalisation de la part d'une équipe australienne qui est parvenue récemment à combiner calcul quantique et calcul classique.
L' utilisation d'une architecture nommée Quantum Kernel-Aligned Regressor a permis à ces chercheurs de traduire des données expérimentales classiques vers un langage compréhensible par un processeur quantique. Les éléments en question ont pu ensuite être renvoyés vers un algorithme classique. Ce couplage entre quantique et classique permet d’exploiter les avantages de la finesse d’analyse des qubits et la robustesse des outils statistiques classiques. D'où la question : le cerveau humain a-t-il pu évoluer vers cet éventail de possibilités ? Comme bien souvent en science, il faudra attendre les résultats de bien d'autres travaux avant de pouvoir répondre à cette question.