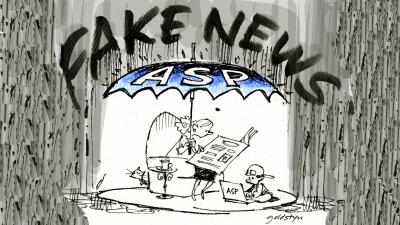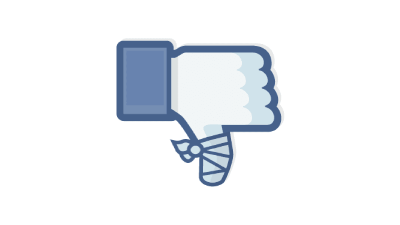Une journaliste de la revue Forbes voit trois raisons. Un chroniqueur du New York Times en voit une seule. Mais au final, ils se rejoignent: une mauvaise communication, et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Par exemple, dire à répétition que la grippe cause plus de morts qu’Ebola, donc que pour cette raison, nous paniquons trop à propos d’Ebola, était une mauvaise stratégie, écrit la journaliste Faye Flam. «Nous savons tous que nous allons mourir un jour», mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir peur de ce qui nous est inconnu. «Une bonne question à poser est plutôt pourquoi le scénario que nous voyons en Afrique de l’ouest ne se produira pas aux États-Unis.»
Difficile de vulgariser le risque
Cela, ajouté au fait que vulgariser l’incertitude est une des tâches les plus difficiles qui soient: les termes «peu probable» ou même «très improbable», qui ont une signification précise en science ou en médecine, ne sont pas du tout interprétés de la même façon par quelqu’un qui a déjà décidé de croire qu’il y avait un risque.
À ce sujet, l’histoire des sismologues italiens poursuivis en justice pour avoir soi-disant «failli» à communiquer le risque d’un tremblement de terre, est en train de devenir un cas d’espèce de la difficulté à communiquer le concept d’incertitude.
L’auteur américain David Ropeik s’est fait une spécialité de critiquer la méconnaissance généralisée de la notion de risque chez ceux qui communiquent, qu’ils soient journalistes, activistes ou chercheurs: dans le cas du nucléaire par exemple, après l'accident de la centrale de Fukushima, ou dans le cas des changements climatiques.
Anti-élitisme
Mais tous ces problèmes de communication se heurtent à un dernier problème, plus profond, écrit le chroniqueur Richard Perez-Pena dans le New York Times : une anttitude anti-élite et anti-intellectuelle très présente dans la société, au point où, aux yeux d’une personne qui a déjà décidé qu’elle aurait peur d’Ebola, quiconque cite des sources scientifiques est étiqueté comme «élitiste».
Les Américains ont été particulièrement vulnérables: parce qu’ils étaient cet automne en campagne électorale, un politicien qui annonçait des mesures de quarantaine pour quiconque revenait d’Afrique de l’Ouest se donnait du coup une image positive «anti-establishment».
Interrogé par le Times, l’expert en maladies infectieuses Daniel J. Diekema résume à sa façon la vision naïve qu’ont certains de ses collègues chercheurs: «lorsque nous publions des avis, nous avons tendance à penser que tout ce que nous avons à faire est de présenter les faits. Mais ça ne suffit pas toujours, et il nous faut être sensibles aux peurs des gens». Un débat en cours dans les sciences de la communication appelle cela le «modèle du déficit»: c’est-à-dire la vision naïve qu’ont beaucoup de chercheurs à l’effet que, quel que soit le sujet (Ebola, le climat, l’alimentation, etc.) le public souffrirait d’un «déficit» de connaissances et qu’il suffirait donc de lui communiquer des faits scientifiques solides pour qu’il «comprenne». De toute évidence, avec Ebola, ça n’a pas été suffisant.