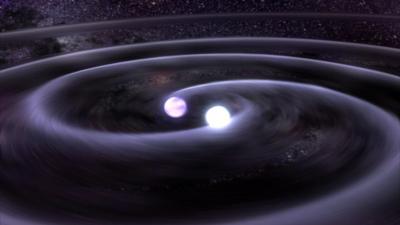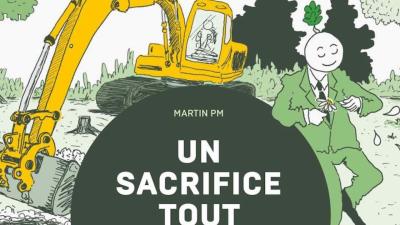La confiance en la science ne gagne pas du terrain depuis la pandémie. Elle ne semble toutefois pas en perdre beaucoup plus, selon certains sondages – on pourrait donc avoir atteint un plancher – et ce, alors que les scientifiques ont le tort de très mal ou de très peu communiquer avec le public.
À lire également
« Il importe de prendre des décisions les plus éclairées possible, mais comment le faire lorsque l’information scientifique est mise à mal en raison des fausses nouvelles et de la désinformation? », s’alarmait le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, en ouverture du récent Forum organisé par le Fonds de recherche du Québec sur « La confiance dans la science : une question de communication ? ».
87 % des Américains pensent que les scientifiques agissent dans le meilleur intérêt du public. Mais seulement 45 % pensent qu'ils sont de bons communicateurs, comme on pouvait le lire dans le récent sondage du Pew Research Center.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Les scientifiques devraient-ils apprendre à mieux communiquer? Sans doute, mais pas seulement. « Les gens veulent des réponses rapides et nous, les scientifiques, nous avons besoin de prendre le temps pour y réfléchir. Ce n’est donc pas facile d’arrimer les deux », convient le professeur au Département des relations industrielles de l’Université Laval, Simon Coulombe.
Il constate que la jeune génération se tourne vers les réseaux sociaux pour trouver des réponses, ce qui peut nuire à sa santé, physique et mentale. « Comment aider les personnes qui sont plus susceptibles de croire des choses fausses? Ils doivent apprendre à discerner ce qui est solide ou pas et nous avons sans doute un rôle à jouer. »
La présence de nombreuses personnes au micro qui remettaient en question la gestion de la pandémie témoignait de cette réalité.
Communiquer, vulgariser, former
Les scientifiques sont pointés du doigt pour leur manque de compétence – ou d’intérêt - en matière de vulgarisation. Il fut un temps où les freins se multipliaient pour éteindre l’intérêt à faire plus de communication scientifique: manque de formation, de valorisation des initiatives de vulgarisation, de rétribution par les institutions du temps passé à ce type d’activités…
Mais ce n’est plus le cas et la jeune génération se montre plutôt enthousiaste. « Ce sont majoritairement des étudiants, à plus de 80%, qui participent à nos activités consistant à faire de courtes présentations vulgarisées de leurs travaux scientifiques. On les forme, on leur donne des conseils et un guide d’information et on leur rappelle que cela doit être avant tout du plaisir », explique le directeur général de BistroBrain, Alexis Thibault.
Depuis la pandémie, la valorisation de la communication scientifique progresse aussi au sein des institutions. « On doit traduire ce qui se fait dans les labos et on doit faire un bout pour soutenir ces initiatives. Nous avons une responsabilité sociale, comme institution, de faire apprécier la science », affirme Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l’Université de Sherbrooke.
Les scientifiques au sein des universités ont souvent besoin d’être accompagnés, ajoute Sophie Langlois, directrice générale au Bureau des communications et des relations publiques de l’Université de Montréal : « il faut accepter de faire la « game » des médias. Ceux qui acceptent de jouer ce jeu-là, on leur donne des ateliers de formation et des trucs : parler simplement, comme à sa mère par exemple. » Parce que les médias privilégient souvent un clip, une courte phrase.
« Il y a peu de place pour les nuances et on va éliminer les notions complexes et moins importantes. Cependant, on va travailler l’interaction avec le scientifique et l’aider dans la mise en récit de la science », ajoute l’ancienne journaliste scientifique de Radio-Canada, Chantal Srivastava, depuis peu employée par l’Université de Montréal.
Une place pour le dialogue
Reste qu’en parallèle, on observe sur la place publique et sur les réseaux sociaux une montée de l’hostilité et des avis qui se radicalisent, créant l’impression d’une crise de confiance généralisée.
« La confiance, c’est complexe et ça dépend du contexte. Les sciences ne sont pas remises en cause, mais souvent convoquées, car on leur accorde du crédit et on va vouloir en discuter », soutient le professeur au Département de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal, Alexandre Coutant.
Alors, serait-ce une question de mauvaise communication, ou un manque d’un espace pour le dialogue ?
« Il faut peut-être démocratiser la formule de vulgarisation », suggère le professeur à l’École nationale d’administration publique, Martin Goyette. Il pense en cela à son propre cas : ayant mené des recherches sur les jeunes et l’itinérance —plus du tiers des jeunes avec un parcours étendu en protection de la jeunesse (DPJ) connaissent au moins un épisode d’itinérance— il se fait régulièrement accompagner par certains de ces jeunes lorsqu’il parle de ce qu’il fait. « Les jeunes doivent prendre la parole bien avant les scientifiques, ce sont les experts d’expériences», ajoute le cotitulaire de la Chaire réseau de recherche sur la jeunesse du Québec.
« Les décideurs décident par des chiffres et les jeunes issus des services de la DPJ consomment 40 fois plus des ressources pour les itinérants » que les autres jeunes. « Mais au delà du chiffre, il y a toute une nuance et des subtilités pour rendre compte de cette complexité. Les jeunes peuvent nous y aider ».
Alexandre Coutant est d’avis qu’Il manquerait peut-être d’espace pour un dialogue bienveillant, des échanges et une écoute plus proactive des opinions divergentes que suscitent les questions scientifiques.
Il pense qu’il importe d’accepter de rencontrer et de discuter avec le public. « Je crois en l’existence d’une intelligence collective et en la bonne volonté des gens. Il faut les accompagner en soulignant les erreurs et prendre le temps de discuter. »
Dans cet « espace de curiosité collective » comme il l’appelle, il importe de s’atteler à maintenir la confiance en misant sur la compétence des experts, la probité et le bien commun. Il faut aussi ne pas se détourner des réseaux sociaux.
« Les réseaux offrent la possibilité d’avoir une discussion démocratique, avec toutes les voix et pas juste celles des scientifiques », pense le chercheur.
Il importe, par exemple, de miser sur l’écoute et la participation de ceux qui vivent les situations étudiées, tels que les patients partenaires qui souhaitent reprendre du pouvoir sur leur maladie.
« C’est cohérent avec mes valeurs, on veut réduire les inégalités sociales, c‘est naturel de mettre au cœur de nos pratiques les citoyens vulnérables économiquement », note la titulaire de la Chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé de l’Université du Québec à Montréal, Janie Houle. « Ils sont impliqués dans toutes les étapes », note-t-elle.
Au même titre que les étudiants, ces pairs chercheurs sont impliqués dans la gouvernance de la Chaire, ils participent à la prise de décision, à la recherche, la rédaction et même la valorisation des travaux de recherche. « Ils rendent la recherche meilleure et utile et cela éclaire ce qu’ils vivent. C’est comme cela que l’on bâtit une relation de confiance et de réciprocité », relève la Pre Houle.
Cela s’avère même indispensable à ses projets de recherche, tel que Vers une société plus juste, qui vise à diminuer ces préjugés et à proposer des améliorations aux politiques publiques en matière de réduction des inégalités sociales de santé.
Accès aux soins de santé, loyers modiques: les espaces de discussion vont donc être favorisés afin de déployer les questions et les pistes de solution ensemble. « Et on a même créé un espace pour les pairs, où ils se forment entre eux et peuvent parler de ce qu’ils vivent », ajoute la Pre Houle. Une communication à plusieurs niveaux privilégiant les échanges horizontaux et l’écoute: peut-être une solution pour reconstruire des ponts avec le public.