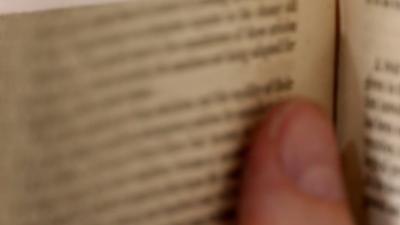Depuis des années, des « usines à articles » produisent frauduleusement de faux articles scientifiques au bénéfice de gens désireux de gonfler leur CV. Une étude statistique révèle que cette production douteuse augmente assez vite pour que l’on commence à s’en inquiéter.
À lire également
Le principe est même devenu lucratif pour ces « usines » (en anglais, paper mills) : à travers le monde, des gens sont prêts à payer des centaines, voire des milliers de dollars, pour que leur signature soit ajoutée à un article de recherche qui n’a peut-être rien de scientifique, article qui sera publié dans une revue qui n’a de scientifique que le nom: soit parce qu’il s’agit d’une revue créée à cette fin, soit parce que l’éditeur fait partie du réseau frauduleux.
Ces pratiques sont apparues au grand jour au fil des années, par exemple lorsque des lanceurs d’alerte dénonçaient, lorsque des enquêteurs indépendants détectaient des cas de textes plagiés ou d’images manipulées, ou lorsque des rétractations d’articles survenaient en série, autour d’un même auteur ou d’un même éditeur.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
À partir de ces « signalements », cinq chercheurs en sciences sociales de l’Université Northwestern (Illinois) et de l’Université de Sydney (Australie) ont dressé une liste de 30 000 articles suspects. Il s’en dégage des liens intrigants, comme des « noyaux » d’éditeurs et d’auteurs qui semblent travailler de concert, ou comme des images qui réapparaissent d’un article à l’autre.
Cela a permis de confirmer l’existence de réseaux. Déjà, en avril dernier, trois chercheurs européens pointaient, sans surprise, la Russie, l’Iran et la Chine. Dans la nouvelle étude, parue en août, les cinq chercheurs démontrent l’existence de réseaux qui, en plus de ces auteurs et éditeurs, impliquent des « courtiers » qui ciblent un certain nombre de publications qui seraient susceptibles de publier leurs articles. « Nos résultats révèlent certaines des stratégies qui permettent à ces entités de promouvoir la fraude scientifique » tout en réduisant les risques d’être repérés.
Une des enquêteuses qui a permis ces dernières années de mettre à jour plusieurs études suspectes, la microbiologiste californienne Elisabeth Bik, qui n’a pas participé à cette étude, la commente dans le New York Times: « c’est fantastique de voir tout le travail que nous avons fait être maintenant solidifié dans une analyse de haut niveau ».
Cette forme très particulière de fraude s’inscrit dans le contexte où, depuis des décennies, l’avancement professionnel d’un jeune chercheur dépend largement du fait de réussir à publier ses études: c’est le fameux adage « publier ou périr » (publish or perish). Il est possible que le phénomène ait été amplifié par l’émergence de pays dont la communauté scientifique peine à s’imposer sur la scène internationale. S’est ajouté à cela une croissance du nombre d’étudiants chercheurs plus rapide que la croissance du nombre d’emplois dans les universités.
Le résultat est inquiétant, soulignent les cinq chercheurs. Et l’émergence des IA capables de générer un article en quelques secondes ne va pas améliorer la chose. Selon leur estimation —basée sur ce qu’ils reconnaissent être un échantillon incomplet des publications frauduleuses— le nombre de nouveaux articles « suspects » doublerait tous les 18 mois, alors que le nombre total d’articles scientifiques double tous les 15 ans. Si leur estimation est juste, c’est une crise qui se prépare.
Mais même si leur estimation devait être revue à la baisse, le problème des articles frauduleux et des incitatifs à les publier n’en est pas moins réel, et la communauté scientifique doit poser des gestes, propose le professeur de génie Luís A. Nunes Amaral, de l’Université Northwestern, dans la revue Inside Higher Education: « nous devons rendre les gens redevables des articles dont ils affirment être les auteurs », et un chercheur reconnu responsable d’un tel dérapage « devrait être interdit de publication pendant une période de temps ». Il faut par ailleurs « activer la détection [des fraudes] les conséquences et la mise en oeuvre de ces conséquences », autant dans les universités que dans les organismes subventionnaires et les revues scientifiques sérieuses.