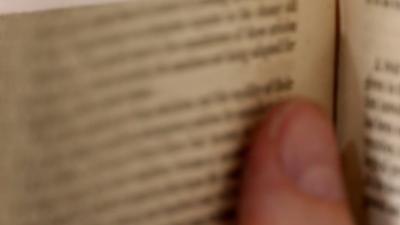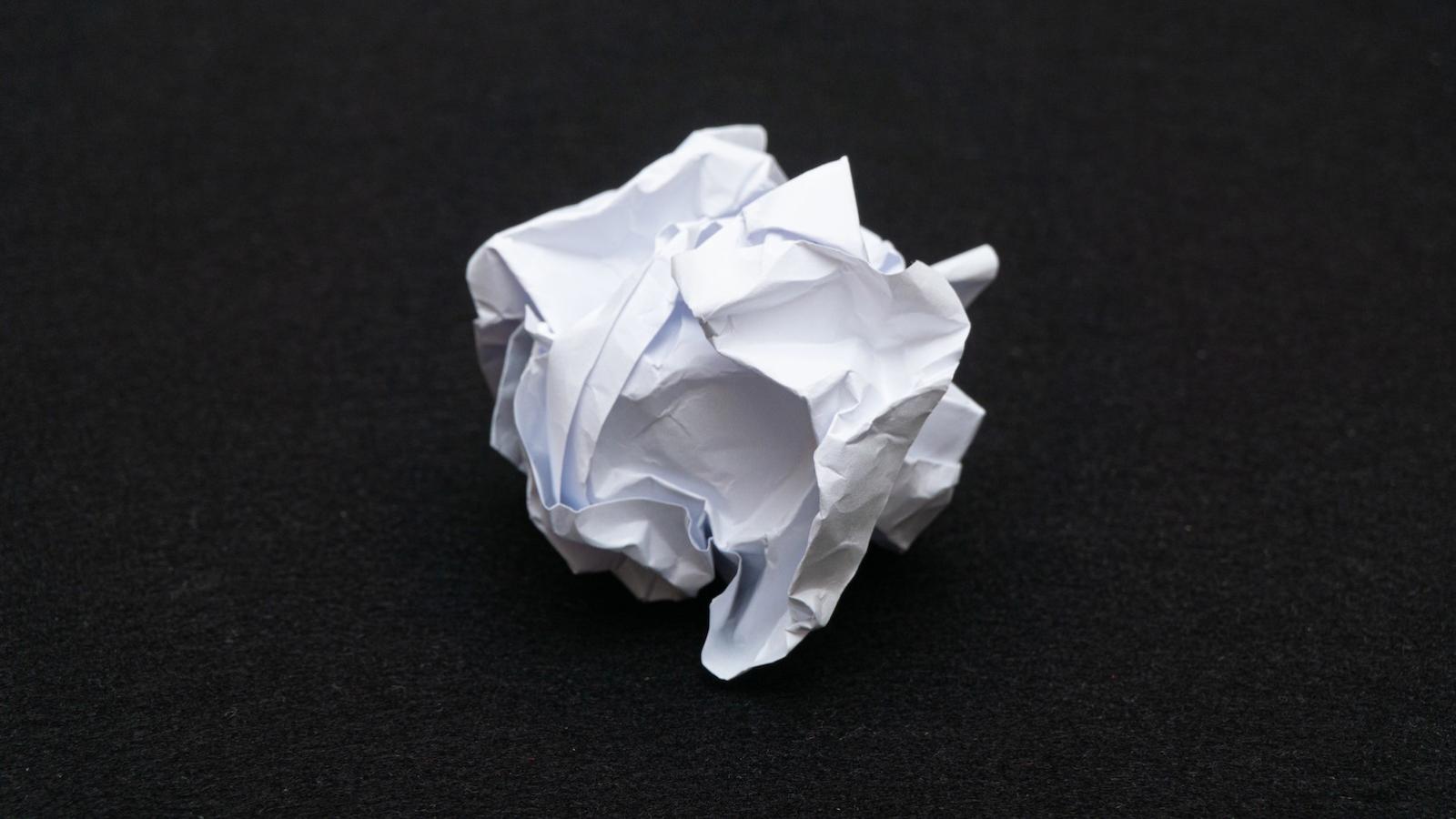
La rétractation d’articles est un phénomène gênant pour la communauté scientifique, même si ça ne concerne qu’une minorité de recherches. Mais les bases de données constituées par ceux qui suivent ce dossier depuis deux décennies permettent désormais d’identifier les « points chauds »: les institutions, voire les pays, où se fait le plus de « mauvaise science ».
À lire également
La revue britannique Nature vient de publier la plus importante compilation des différentes bases de données en question. Elle reconnaît qu’il y a des limites à l’exercice: les données sur les rétractations —c’est-à-dire les articles qui ont été retirés des archives des revues pour cause de fraude, d’erreurs ou de méthodologies douteuses— ne sont pas uniformisées et les auteurs des recherches ne sont pas toujours identifiés aux bonnes institutions. Les résultats doivent donc être considérés comme préliminaires.
Néanmoins, il se dégage des tendances.
- D’une part, la Chine: plus de 60% des articles rétractés comptent au moins deux auteurs de ce pays parmi leurs signataires. L’Éthiopie, l’Arabie Saoudite, l’Irak, le Pakistan et la Russie ont eux aussi des pourcentages de rétractation plus élevés que la moyenne, mais produisent moins de recherches.
- D’autre part, lorsqu’une institution ressort plus souvent du lot, il s’avère que ses rétractations sont réparties parmi plusieurs auteurs, ce qui tendrait à démontrer qu’il s’agit d’un problème de « culture » dans cette institution, et non d’une seule équipe de chercheurs qui aurait un nombre record de recherche douteuses.
Abonnez-vous à notre infolettre!
Pour ne rien rater de l'actualité scientifique et tout savoir sur nos efforts pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation!
Au moins les deux tiers des institutions avec un taux de rétractation supérieur à 1% sont en Chine. Nature précise avoir essayé de rejoindre chacune de ces institutions pour obtenir des commentaires, et ne pas avoir eu de réponse. Ailleurs, des institutions comme l’Université Ghazi au Pakistan, l’Institut de technologie KPR en Inde, ou l’Université du Roi-Saoud, en Arabie saoudite, ressortent également du lot. Dans l’ensemble, celles qui figurent en haut de la liste sont souvent de petites institutions.
Déjà en 2020, le ministère chinois de la science avait publié des lignes directrices pour combattre la fraude en science et il a lancé en 2024 une vaste enquête sur le sujet.
Le phénomène de la rétractation représente tout de même, dans l’ensemble, quelque chose de rare. Sur plus de 50 millions de recherches publiées dans la dernière décennie, environ 40 000 ont été rétractées, soit moins de 0,1% (la moyenne est de 0,3% en Chine). Mais le nombre est en augmentation, ce qui pourrait être tout autant causé par l’émergence « d’usines à articles » (en anglais, paper mills)… que par le fait que les mécanismes de surveillance sont plus nombreux et permettent de détecter plus souvent les fraudeurs. Dans tous les cas, note Nature dans un éditorial accompagnant sa recherche, une telle compilation peut avoir un impact positif : identifier les moutons noirs et forcer les institutions fautives à prendre des mesures.